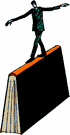|
Tout
récit implique:
une histoire qui se déroule avec des personnages,
dans un lieu et un temps;
une narration qui suppose certains choix dans le mode
de présentation des faits, dans l’organisation du texte.
Lire un récit, c’est donc suivre une histoire, et surtout
identifier ce mode de narration, en se demandant qui raconte les faits
(narrateur) et qui les perçoit (point de vue)
|
Le
narrateur |
|
|
On ne confondra pas l’auteur, être de chair et d’os
qui vit ou a vécu dans notre monde, et le narrateur, être
virtuel qui est censé raconter l’histoire et qui se définit
d’après les indices fournis par le texte.
La position du narrateur, c’est la place qu’il occupe
par rapport à l’histoire: ou bien il la raconte du dehors,
ou bien il participe à cette histoire en tant que personnage.
Le narrateur hors de l’histoire
- même extérieur à l’histoire, le narrateur
peut livrer dans sa narration des traces de sa présence: le
récit au sens strict laisse alors place au discours; des indices
d’énonciation signalent la présence de quelqu’un
qui juge les personnages, organise le récit, propose des réflexions.
- pour entretenir davantage l’illusion réaliste, le romancier
peut choisir de dissimuler la présence du narrateur: les faits
semblent alors se raconter d’eux-mêmes, sur le mode du
récit pur (3ème personne, temps du passé), les
marques du discours n’apparaissent que dans les dialogues.
Le narrateur personnage
- le narrateur raconte sa propre histoire: le héros rapporte
l’aventure qu’il a vécue. Le lecteur peut ainsi
avoir l’impression d’entrer de plein-pied dans l’histoire.
- le narrateur peut aussi raconter des faits dont il n’a pas
été l’acteur principal mais simplement un témoin,
à distance du héros que l’on découvre alors
de manière indirecte.
Le romancier opte parfois pour un dispositif complexe qui combine
ces différentes possibilités: un premier narrateur laisse
la parole à un second; le narrateur que l’on croyait
«au dehors» révèle qu’il a participé
aux faits, etc. De telles structures peuvent difficilement être
repérées dans les limites d’un extrait, mais il
est important de les identifier dans une œuvre complète.
|
Les
points de vue narratifs |
|
|
Il ne suffit pas
d’identifier le narrateur pour déterminer le point de
vue, la perspective selon laquelle les événements de
l’histoire sont perçus et présentés. Si
le narrateur personnage rapporte généralement les faits
en fonction du point de vue limité qui est le sien (sa vision,
son savoir, sa réflexion), le narrateur situé hors de
l’histoire peut choisir entre trois types de points de vue:
le point de vue omniscient: les informations données
par le narrateur dépassent le savoir et les possibilités
de perception des personnages. Le narrateur raconte à la manière
d’un historien qui sait tout, change librement d’angle
de vue, dévoile les pensées secrètes des personnages,
se déplace d’un lieu à l’autre, effectue
des retours en arrière. Cette technique ouvre de vastes possibilités
à l’analyse psychologique, mais comporte des risques
d’invraisemblance puisqu’elle suppose un narrateur aux
pouvoirs surhumains.
le point de vue interne: les informations données
par le narrateur coïncident avec le savoir d’un personnage.
La réalité décrite est limitée par les
possibilités d’une perception subjective, que ce soit
celle d’un narrateur-personnage ou d’un personnage qui
n’est pas narrateur. Cette technique impose des contraintes,
mais rend vraisemblables les éléments de l’histoire,
puisque ceux-ci passent par un point de vue humain limité dans
lequel le lecteur peut facilement se reconnaître.
le point de vue externe: les informations données
par le narrateur restent en-deçà de ce que sait le personnage.
Les faits et gestes sont présentés d’un point
de vue purement objectif, tels qu’ils pourraient être
enregistrés par l’œil d’une caméra,
sans l’interprétation d’une conscience. On ne connaît
donc pas les pensées des personnages décrits. Cette
technique est fréquemment utilisée au début d’un
roman, lorsque le romancier veut attirer l’attention sur l’inconnu
qui entre en scène. On la rencontre surtout dans les romans
contemporains, en partie sous l’influence du cinéma.
Comme il y a souvent des variations de points de vue, il ne faut pas
s’empresser d’étendre à tout un roman la
technique repérée dans un extrait; par contre, la connaissance
du roman intégral aide à mieux analyser le point de
vue utilisé dans un passage.
|
| Les personnages |
|
|
La qualification
du personnage
Un personnage de roman n’est pas une personne: il est un être
de papier, qui n’existe que dans les mots du texte. Et pourtant,
le lecteur prend souvent le personnage pour une personne: il est tenté
de le juger, il éprouve pour lui sympathie ou antipathie. Le
romancier parvient à provoquer cette illusion grâce à
des procédés de désignation, de qualification
et de présentation.
Désignation: le personnage existe par son
nom. Le nom peut par lui-même signaler une origine, une catégorie
sociale. Il contient parfois un jeu de mots qui fait sens (chez Balzac,
l’avare Gobseck = gobe sec). Il arrive que des changements de
nom (Jean Valjean > M. Madeleine) accompagnent les rebondissements
de l’intrigue. Un personnage existe grâce à l’ensemble
des appellations (noms, surnoms) et des mots-outils (pronoms) qui
le désignent. Ces dénominations peuvent être révélatrices
de son évolution, ou des regards que les autres personnages
portent sur lui.
Qualification: le romancier donne au personnage une
identité physique, psychologique et morale, sociologique: -
le personnage physique: un corps avec ses traits caractéristiques,
avec des constantes (couleur des yeux, des cheveux, taille grande
ou petite...) mais aussi des détails particuliers qui «font vrai».
- le personnage moral: le texte s’attache à l’expression
des sentiments, s’intéresse à leurs manifestations
extérieures (larmes, sourires, gestes significatifs). Le romancier
prête au personnage des pensées, des valeurs qui sont
parfois les siennes.
- le personnage social: l’individu appartient à un groupe
social, le personnage reflète un milieu par ses vêtements,
sa profession, son langage, son idéologie.
Modes de présentation: les informations sur
le personnage peuvent parvenir par différentes voies:
-
le narrateur présente directement le personnage: le point
de vue omniscient permet de livrer un portrait détaillé,
de dévoiler le passé du personnage, de révéler
ses pensées.
-
le personnage est présenté par le point de vue d’un
autre personnage.
-
le
personnage nous livre lui-même des informations qui le concernent
soit parce qu’il est lui-même narrateur, soit parce
qu’il parle au discours direct (dans un dialogue).
-
c’est
au lecteur de construire le personnage, de déceler des indices
de sa personnalité dans ses comportements (présentés
d’un point de vue externe), ou encore dans le décor:
l’espace décrit informe sur l’«état
d’âme» du personnage qui l’habite ou qui
le voit.
Fonction
des personnages dans l’action
Dans un roman, tous les personnages forment un système dans
lequel ils se définissent les uns par rapport aux autres, avec
des rôles différenciés. Dans ce système,
le personnage ne se situe pas seulement par son être mais surtout
par son faire, par la part qu’il prend à l’action,
c’est-à-dire par sa fonction.
Les fonctions des personnages dans un récit se groupent en
six classes: - le sujet, qui accomplit l’action,
qui poursuit un but; - l’objet: le but de l’action,
ce que vise le sujet; - l’adjuvant, qui aide
le sujet dans son action; - l’opposant, qui
fait obstacle à l’action du sujet; - le destinateur,
qui détermine la tâche du sujet, lui propose l’objet
à atteindre; - le destinataire, qui reçoit
l’objet et sanctionne le résultat de l’action.
Établir le schéma de l’action dans un texte, c’est
identifier ces six fonctions. Cela ne veut pas dire qu’à
chaque personnage corresponde une fonction fixée une fois pour
toutes: un même personnage peut exercer plusieurs fonctions.
De même, une même fonction peut être exercée
par plusieurs personnages (ou par des forces qui ne sont pas des personnages:
une institution, un groupe, un élément, une valeur).
C’est la relation entre ces fonctions qui fait progresser le
récit.
Ce schéma ne doit pas être appliqué de façon
mécanique: il doit surtout aider à lire le récit
comme une dynamique, et à y reconnaître des constantes,
des rôles-types.
La structure de l’action
La construction de l’intrigue, elle aussi, obéit à
des lois. Pour qu’il y ait récit, il faut au moins une
action transformatrice, c’est-à-dire le passage d’un
état à un autre. L’épisode de base comporte
cinq étapes:
-
l’état initial: la situation première, l’équilibre
qui précède l’action
-
la complication (force perturbatrice): le méfait, le manque,
l’événement qui rompt l’équilibre
et déclenche l’action;
-
la dynamique: l’épreuve, le conflit, les péripéties
éventuelles
-
la résolution (force équilibrante) qui met un terme
à l’épreuve;
- l’état
final: un nouvel équilibre, qui peut à son tour être
le point de départ (l’état initial) d’un
nouvel épisode.
Une telle structure caractérise non seulement de brefs épisodes
narratifs, mais des récits entiers: tout roman est passage
d’un état initial à un état final, et la
comparaison entre la première et la dernière page permet
de mesurer la transformation accomplie.
|
| Le récit
et le temps |
|
|
Moment
de la narration et moment de l’histoire
Il existe quatre possibilités pour situer le moment où
le narrateur raconte par rapport au moment de l’histoire racontée:
- la narration ultérieure: le moment de la
narration se situe après le moment de l’histoire. C’est
le cas le plus fréquent du récit rétrospectif:
le narrateur raconte une histoire qui s’est passé dans
le passé. La distance entre le moment de l’histoire et
le moment de la narration est variable: les faits relatés peuvent
se situer dans un passé très lointain ou être
très proche du narrateur.
- la narration simultanée: la narration s’accomplit
en même temps que l’histoire. Tel est le cas dans un récit
au présent.
- la narration antérieure: la narration se
situe avant l’histoire. C’est le cas exceptionnel d’une
prophétie, d’une prédiction. Cette possibilité
peut se rencontrer dans un court passage, rarement dans un récit
complet.
- la narration intercalée: la narration alterne
avec l’histoire. Par exemple, dans un roman par lettres ou dans
un journal intime.
Ordre de la narration et ordre de l’histoire
Les rapports entre l’ordre de la narration et l’ordre
de l’histoire sont de deux types:
Durée
de la narration et durée de l’histoire
C’est la comparaison entre la durée de narration et la
durée de l’histoire qui permet de mesurer la vitesse
narrative, c’est-à-dire l’accélération
ou le ralentissement de l’histoire. Le temps de la narration
se mesure en lignes, en pages, en volume de texte; le temps de l’histoire
se mesure en heures, jours, années, au niveau de l’action
racontée. Le rythme varie en fonction du rapport entre les
deux. On distingue cinq vitesses:
- la pause: elle suspend le temps de l’histoire:
il y a comme un «arrêt sur image». Le temps de
la narration, lui, continue de s’écouler; le narrateur
a alors tout le loisir de développer un portrait, ou un commentaire.
On aura moins de narration et plus de description, ou bien le récit
laisse place au discours.
- le ralenti: la narration développe longuement
ce qui ne prend que très peu de temps dans l’histoire:
le récit peut «étirer» l’évocation
de quelques secondes, pour renforcer par exemple la tension dramatique,
ou pour s’attarder sur le cadre de l’action sans interrompre
son déroulement.
- la scène: elle correspond à une relative
équivalence entre les deux temps. Le récit est mimétique,
c’est-à-dire qu’il semble imiter le temps réel.
Cela peut être un dialogue au discours direct, ou une narration
mêlée de détails descriptifs qui paraissent suivre
les découvertes successives d’un personnage.
- le sommaire ou le résumé:
le récit est réduit à quelques lignes du texte
pour des actions qui prennent du temps. L’impression mimétique
se dissipe et le récit semble s’accélérer.
- l’ellipse: la narration passe sous silence
une période de l’histoire: le temps vécu par les
personnages continue de s’écouler, mais le récit
passe directement à un autre moment de l’action.
Pour établir avec précision le rythme d’un texte
narratif, on ne négligera aucun des indices de temps fournis
par le texte: champ lexical du temps, données chiffrées,
prépositions et conjonctions, verbes ou adverbes précisant
l’ordre ou la durée des événements, temps
des verbes…
On pourra alors apprécier les variations de rythme, leurs effets
dramatiques et le tempo qu’elle donne à une page de récit.
|