opinions et entretiens avec l'auteur
opinions de François Devinat
Libération, le 20/10/97
|
|
Mon chef venait de lire Messieurs les enfants. Il a voulu faire son Crastaing, le prof du bouquin qui, en guise de colle à ses cancres, leur demande d’imaginer qu’ils se transforment en parents pendant que leurs parents se transforment en enfants.
|
|
Il m’a tendu son libellé. Montrez comment Daniel Pennac est devenu le pain béni des enfants zappeurs, le saint Graal de leurs parents et le denier du culte des éditions Gallimard. Pour analyser le processus de béatification galopante, vous n’hésiterez pas à vous rendre à Belleville, dans le sanctuaire de la tribu de Benjamin Malaussène, son pitoyable prophète... |
|
|
Le collé s’est retrouvé chez Ahmed, le libraire où Pennac a ses habitudes, rue des Pyrénées. Ahmed s’est mis à l’enseigne de la Fée carabine, deuxième tome de la saga des Malaussène, un vrai carton traduit en dix-huit langues, qui fait passer son auteur de la cave de la Série noire de Gallimard au grenier à blé de la collection blanche NRF, avant d’être vaporisé en Folio. Ahmed se souvient du temps où Daniel Pennac traquait le moindre entrefilet parlant de lui. Le temps des contes pour enfant et des premiers romans ignorés, avant que Malaussène fasse un malheur. C’était un plaisir de trouver un article sur lui. |
|

|
Maintenant, il est partout, même dans Figaro Madame. Un cyclone éditorial: 240 000 exemplaires de Messieurs les enfants mangés en un mois de parution, après son essai sur la lecture (Comme un roman) vendu à 650 000 exemplaires, et la duplication à 800 000 exemplaires de la trilogie des Malaussène. On commence à me demander s’il n’y a pas du business derrière, rigole Ahmed. Je ne lui souhaite pas le prix Goncourt!... |
|
A deux pas de là, Pennac est précisément en plein business: trois heures de queue sur le trottoir d’une autre librairie où il signe sa copie à tour de bras, entre un enregistrement chez Chancel et un Cercle de Minuit. Pennacomania tendance lycéenne, métissée comme la planète Belleville écumée par la tribu Malaussène. C’est génial: on voit les images en même temps qu’on lit; je me marre tout seul dans le métro, dit un accro du style cravacheur de Pennac. J’aime son regard, l’étincelle d’humanité qu’il trouve dans le pire salaud, confesse un autre. Pas chiant, bon enfant en diable, emballé dans un supplément d’âme tendance SOS-Racisme, ce serait ça le secret de la martingale? Il ratisse large, le bougre: l’ultime dédicace est pour Valentin, 7 ans, un vieux bouquin de la série Kamo à la main. |
|
|
Comme il a le cœur aussi large que le présentoir de la Fnac Forum des Halles réservé à ses livres Ça se vend comme des petits pains, soupire la vendeuse qui préfère Le Clezio; Pennac veut bien m’aider pour ma colle. M’entraîne dans un endroit calme, un resto couscous sur les hauteurs de Belleville, où le seul consommateur présent se rue bientôt vers lui. Au bord des larmes, il arrache un autographe à la sainte apparition sur un bout de nappe en papier. Pour le vingtième arrondissement s’il vous plaît! Vive le vingtième arrondissement! écrit Pennac. |
|

|
|
|
Chez Gallimard, l’heureux gagnant est d’autant plus choyé qu’il paye de sa personne. Pennac? Gentil. Trop même. Il a du mal à dire non. Faut presque jouer les garde-chiourme à sa place... Ivresse des sommets et d’un magistère médiatique qui nous prendrait tous pour ses bons élèves? Ou vous acceptez les sollicitations, et on vous le reproche. Ou vous refusez, et on dit pour qui se prend-il! C’est compliqué la simplicité. Qu’est-ce qu’il faut faire? Rien d’autre, apparemment, que brancher l’oxygène artificiel pour continuer l’ascension d’un Everest démarré à pas comptés... |
|
|
Un an pour assimiler la lettre A, à l’âge de 5 ans. Dans vingt-cinq ans, il possédera l’alphabet, disait mon père. Un monument, ce père. Corse, officier de la coloniale grimpé général et pas une once de racisme. Dernier de cordée après trois frères et canard boiteux, Daniel coupera son patronyme (Pennachioni) par peur d’embarrasser son géniteur en signant son premier écrit, un pamphlet sur le service militaire . Pennac ne serait-il jamais qu’un homme coupé en deux, fils éternel bloqué au pays de Peter Pan et de Gaston Lagaffe, qui aurait troqué les balais de sorcières en pétoires pour régler ses comptes d’enfant triste? |
|
|
Des Crastaing, qui vous figent un gosse en statue de sel, il en a connu dans l’exil du pensionnat, où il prenait le maquis dans ses lectures clandestines. Devenu grand, il reviendra en sauveur de l’enfance poignardée sur les lieux du crime de tous les Crastaing: nommé dans un collège de Soissons pour son premier poste, au lendemain d’un Mai 68 oblitéré par une romance. Une seconde naissance, étant entendu que pour Daniel Pennac, la mise au monde originelle tient du parachutage en 40 sur la patrie occupée. |
|

|
Tout professeur de l’être qu’il devient (boudant l’agrégation), Pennac se retrouve dans le camp des adultes, ces perdus d’enfance. Entre deux tas de copies à corriger, l’écriture lui fait traverser le miroir à rebours. Il semble ainsi éponger l’intarissable chagrin de la maturité découvrant que la vie est une mauvaise farce: il faut mourir un jour sans certitude d’avoir l’élégance du désespoir de son père, dont le dernier mot, sur fond d’aboiements, fut: Les chiens ont toujours raison.!... Quand j’écris mes romans, je retourne au temps flottant de l’enfance. Ils sont anecdotiquement cinglés. Mais sans eux, je serais probablement très chiant pour mon entourage. C’est peut être pour ça que j’ai dédié la Fée carabine à la Sécu... Dédicace d’autant plus pertinente que l’amicale des profs prescrit du Pennac sur ordonnance à haute dose aux enfants de la télé, en zakouski à Proust et Flaubert... |
|
Une fille de 15 ans, une compagne écrivain, Belleville à ses pieds, les médias à ses basques et vendu en kit dans toutes les bonnes librairies... Pennac, en congé sabbatique, ne flotte pas pour autant sur un nuage. Dans le cercle des jaloux et des flatteurs, il trouille avant d’écrire et voit Malaussène lui échapper, comme si son auteur ne pouvait plus que décevoir. De gauche, oui. Mais, revenu de tous les points d’exclamation en forme de poteau d’exécution, c’est tout juste s’il a signé la pétition des sans-papiers. Au fond, souffle un ami, il se vit un peu comme s’il n’était jamais qu’un mauvais élève, assis au fond de la classe, qui ne comprend pas bien ce qui lui arrive... Tout ça pour un cancre? Il va m’entendre, le chef.
|
http://www.uni-kassel.de/fb8/privat/kerdelhue/internautes/pennac/pennac.html
le pouvoir des livres, entretien avec Daniel Pennac
Label France - N°39
 |
Romancier, professeur de français et lecteur passionné, auteur à succès d’une saga policière aux personnages aussi fantasques qu’attachants - la désormais mythique famille Malaussène -, Daniel Pennac est l’un des auteurs français les plus traduits et les plus lus dans le monde.
|
Pour Label France, il nous fait partager son expérience d’enseignant, son amour des livres et des élèves, son rapport à la fiction et à l’imaginaire. Entretien.
|
Label France: Comment vous définiriez-vous?
|
|
|
|
Daniel Pennac: Si en m’interrogeant vous imaginez interroger un intellectuel, vous vous trompez, je suis romancier. C’est-à-dire presque le contraire d’un intellectuel. La première obligation du romancier est, en effet, de poser ses valises conceptuelles et de faire en sorte que toute idée soit incarnée. Si vous pouvez résumer un roman par l’idée qui l’a fait naître, il est raté en tant que roman. C’est un essai dissimulé en roman, ce qui est une spécialité française. Céline, qui n’était pas à une provocation près, a tout de même dit quelque chose de très juste: «En matière de roman, il n’y a rien de plus vulgaire qu’une idée.» Je me définirais donc comme un raconteur d’histoires métaphorant.
|
|
Comment voyez-vous l’avenir?
|
|
|
|
Lorsque Benjamin Malaussène déclare à sa Julie: «Julie, je t’aimerai toujours», elle lui répond avec une certaine sagesse: «Contente-toi de m’aimer tous les jours.» C’est ainsi que je vois l’avenir: la conscience passionnée d’un quotidien qui ouvre sur du lendemain. L’avenir «en soi» n’a pas de sens.
|
|
|
|

|
Non, je ne crois pas que le livre, et plus généralement l’écrit, c’est-à-dire ce voyage intersidéral que nous avons fait pour passer du signe au sens au moment où nous avons appris à lire, soit menacé par d’autres modes d’expression. J’attribue un grand pouvoir à l’écrit. J’ai la faiblesse de penser que la découverte d’un mot comme «maman», c’est-à-dire le passage intellectuel de la succession des signes les plus arbitraires à la signification la plus intime, crée un choc dont on ne se remet pas, et que ce choc nous lie définitivement à l’écrit.«L’écrit crée un choc dont on ne se remet pas»
|
|
Les nouvelles technologies, l’internet, etc.?
|
|
|
|
Ce n’est pas la première fois que l’écrit sera dévoyé par des pratiques minimalistes ou utilitaristes. Mais, après tout, l’écrit est autant dévoyé par un mauvais roman, si ce n’est plus. Enfin, l’écrit et le livre ont toujours eu en France une place à part. Notre culture du roman nous tient autant à cœur que notre culture alimentaire.
|
|
Dans votre ouvrage sur la lecture Comme un roman, vous promulguez les dix droits imprescriptibles du lecteur, dont celui de ne pas lire, comme moyen de réconcilier certains jeunes avec les livres. |
|
|
|
L’urgence est de réconcilier ces enfants avec la lecture. Personnellement, je le fais dans les classes en lisant les romans à voix haute, en leur parlant de littérature, en leur «racontant des histoires». Comme un roman avait pour vocation de présenter ma pratique dans ce domaine sans pour autant l’ériger en «méthode». Le problème des enfants qui vivent dans les énièmes cercles de la banlieue, ce n’est pas qu’ils sont atteints d’illettrisme, ce n’est pas qu’ils perdent le goût de lire, c’est qu’ils n’ont même plus le langage oral, parce qu’ils n’ont personne à qui parler. L’oralité est la première des choses qui se perd dans les banlieues où les gosses sont «parqués» dans des blocs, où ils se constituent nécessairement en bandes, où le langage est réduit à des codes de reconnaissance internes à la bande, donc à sa plus simple expression. Les seuls endroits où les jeunes peuvent aller, c’est l’hypermarché, et au bout de la chaîne de l’hypermarché, il y a la caissière, à laquelle on ne parle que de chiffres. |
|
L’école remplit-elle alors son rôle d’ouverture? |
|

|
Avant toute chose, l’école est acculée à jouer un rôle de réinsertion. L’instituteur qui arrive vers ces enfants-là doit, avant de leur apprendre à lire et à écrire, leur enseigner, un, à se comporter, deux, à parler, bref à communiquer, à tenir compte de la présence d’un interlocuteur... C’est, en soi, un énorme travail, qui précède la simple transmission d’un savoir.
|
|
|
|

|
Je n’ai pas de position théorique sur ces questions, parce que je suis bien placé pour savoir que quelque position théorique que l’on ait, il y a toujours un moment, le 6 ou le 7 septembre, quand on rentre en classe, où on est seul devant 35 individus, qui vont constituer une entité vraiment particulière, différente de la classe d’à côté et de toutes celles qu’on a eues. Et à l’intérieur de cette entité, il y a 35 individualités, dont il faut absolument que je tienne compte individuellement si je veux les faire progresser dans quelque domaine que ce soit.
|
|
Mais la transmission des connaissances à l’école est de moins en moins désintéressée.
|
|

|
Bien entendu. Nous, les professeurs, avons tendance, pour notre propre confort méthodologique et pour atteindre les objectifs «rentables» qui nous sont assignés, à nous comporter comme des usuriers: il faut que ça rende, et que ça rende vite! Je te donne une leçon ce soir, il faut que tu me la récites demain. C’est évidemment nécessaire pour donner aux enfants l’habitude de la régularité dans le travail, mais c’est tout à fait insuffisant pour m’assurer que cette leçon sera assimilée et qu’il en restera quelque chose dans dix ans.
|
|
|
|

|
A la Recherche du temps perdu, de Proust. C’est «Le Livre», comme Ulysse de l’Irlandais Joyce. Il y a vraisemblablement le Voyage au bout de la nuit de Céline, qui représente l’intrusion d’une pratique de la langue absolument stupéfiante. Cela dit, autant Proust me donne envie d’écrire, autant Céline me coupe la plume au ras de l’encrier, son écriture m’enthousiasme mais me pétrifie.
Autre roman formidable du XXe siècle, que je place très haut, c’est le Maître et Marguerite du Russe Boulgakov, ou Vie et Destin de Vassili Grossman, un roman bouleversant sur la bataille de Stalingrad et la profonde perversité du stalinisme, qui a valu à son auteur d’être exclu du Parti communiste, de l’Union des écrivains et d’être déporté. Il y a encore Cent ans de solitude du Colombien Gabriel Garcia Marquez mais peut-être davantage l’Amour au temps du choléra.
|
|
Revenons à votre «saga policière». La famille Malaussène est complètement farfelue. Le frère aîné élève ses frères et sœurs à la place de sa mère, grande amoureuse qui va de conquête en conquête. Comment avez-vous inventé ces personnages?
|
|
|
|
Le personnage de Benjamin Malaussène, qui est le père, (mais sans avoir commis le «péché originel» de la conception), de sept ou huit gosses complètement cinglés, est au fond un décalage romanesque de la vie que j’ai menée pendant trente ans en m’occupant des enfants des autres. Mes enfants à moi, ce sont 3500 enfants des autres! Il faut dire que la classe pour un romancier est une mine incroyable de modèles d’adolescents et de familles. C’est le lieu d’observation sociale par excellence. Dans une classe, vous avez le système social tout entier, surtout si tous les milieux sociaux y sont mélangés, comme c’était le cas dans les quinze dernières années de ma vie par la vertu d’une directrice qui réussissait vraiment le «melting-pot».
|
|
|
|

|
Cette femme qui bénéficie de la bienveillance de ses enfants, notamment parce qu’elle est sûrement d’une étrange beauté, dont ils ne se remettent ni les uns ni les autres, qui mène sa vie d’amoureuse aventurière et renaît vierge de chaque couche, est une assez jolie blague romanesque. Parce que, elle aussi, repose sur une femme réelle que j’ai rencontrée. C’est ce qui est plaisant, piper les dés au point que les choses les plus extravagantes soient en réalité celles qui ne sont pas le fruit de votre imagination.
|
|
|
|
|
|
Je suis heureux que cela transparaisse, c’est au fond très personnel. Pour tout vous dire, dès que je suis un peu objectif, je ne trouve pas que le jeu de la vie vaille la chandelle, mais comme on n’en a pas d’autres! Je n’ai rien trouvé de mieux pour rendre la vie attachante que ce qui relève de l’amour, de l’amitié, du sentiment. Mais il est très difficile d’en parler, parce que nous vivons dans un pays où, au moins depuis le XVIIe siècle, vous flatterez quelqu’un en lui disant qu’il est trop intelligent pour avoir du cœur et vous l’insulterez en lui disant qu’il a trop de cœur pour être intelligent.
|
|
Ce discrédit du sentiment est-il d’après vous propre à la France?
|
|

|
Le sentiment est en réalité méprisé dans toutes les sociétés les mieux structurées. On s’en méfie partout parce qu’il représente une force de subversion terrible. Il est absolument inadmissible de penser que l’on puisse vivre par l’énergie que diffuse quelque chose d’aussi aléatoire, d’aussi irrationnel et gratuit que le sentiment! D’où le mariage, d’où la sacralisation, d’où l’éternité de cette étrange menace, «mariés à vie», pour canaliser cette source d’anarchie qu’est l’amour. Si les règles du jeu de l’amour sont dictées par les structures politiques et économiques de chaque pays, il n’en reste pas moins que le sentiment à l’état brut peut apparaître dans n’importe quelles circonstances, absolument partout, et flanquer une pagaille monstre dans le «système»!
|
|
Craignez-vous que la place de l’imaginaire recule dans nos existences sous l’effet de l’emprise toujours plus grande de la technologie? |
|
|
|
La place de l’imaginaire dans la vie humaine est vitale. Selon moi, le domaine de la création artistique quelle qu’elle soit joue pour la société entière le rôle que le rêve nocturne joue chez nous individuellement. Tout se passe comme si la création artistique était une sorte de production de l’inconscient collectif projetée sur les écrans, le papier, les toiles, les formes, la scène... Partout où vous empêchez cette libre expression du rêve communautaire, la société devient folle, comme ce fut le cas de la société nazie, du totalitarisme stalinien, ou aujourd’hui des sociétés intégristes. Le rêve a réellement une fonction vitale, même chez les animaux. Je crois que l’artiste, de ce point de vue, remplit une fonction à la fois gratuite, non rentable et thérapeutique pour la société. Sa folie nous préserve de la folie.
|
Propos recueillis par Anne Rapin
http://www.ratsdebiblio.net/pennacdaniel.html
une interview exclusive de Daniel Pennac (98-99)!
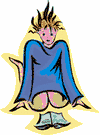
|
Et voilà grâce à mes espions à tavers le monde, j'arrive enfin à dénicher le numéro de téléphone de Daniel Pennac, grand écrivain et très bon prof comme vous pourrez le constater. Le plus dur n'est pas de surmonter la peur mais de joindre le fameux Daniel.Après plusieurs appels téléphoniques sans succès, j'arrive enfin à arranger mon interview téléphonique avec Daniel Pennac.
|
Mes questions sont là, prêtes depuis une éternité mais le trac, le stress embrouillent toutes mes idées. J'arrive néanmoins à m'en sortir tant bien que mal et sans attirer l'attention de Monsieur Daniel. A vous de voir..
|
Journaliste: Bonjour!! euh... comme convenu je vous appelle pour l'interview concemant le journal de mon lycée...
|
|
|
|
Pennac: Tu es en première littéraire, c'est cela? |
|
Journaliste: Euh... oui en effet c'est ça. |
|
|
|
Pennac: et bien, Anaïs qu'est-ce que tu veux savoir? |
|
|
|
|
|
P: oui, au collège; ça fait trente ans tu sais, je suis un vieux monsieur! |
|
J: Euh, quand même... Alors tout d'abord, je voudrais savoir ce que vous pensez du programme de français au lycée? |
|
|
|
P: tu peux me rappeler exactement ce que vous étudiez en premièrere littéraire? |
|
J: On étudie Rousseau, Les Confessions, Giraudoux, Electre et aussi La Fontaine, Les FabJes, Sophocle, bref tout ce qui est tragédie antique et puis d'autres groupements de textes. Est-ce que vous ne pensez pas qu'on nous fait découvrir beaucoup d'écrivains classiques et qu'on oublie un peu les contemporains? |
|
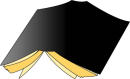
|
P: Vaste question, Anaïs. D'abord c'est pas parce que tu ne trouves pas dans ton programme immédiat des auteurs contemporains, que tu peux d'un revers de main, balayer toute la littérature classique. Quand j'entends, par exemple, qu'on vous enseigne Sophocle, c'est déjà un progrès par rapport à mon époque. Moi, ça m'enthousiasmerait de vous enseigner Oedipe parce que tu as vraiment toute la mythologie, même moderne, comme par exemple, la psychanalyse qui naït du mythe d'Oedipe. C'est une des clés de voûtes de la littérature. Et c'est pas parce que ça a cette importance là que ça doit vous intimider, vous, adolescents. Parce que par ailleurs, c'est une histoire qui est absolument passionnante. Il faut que tu lises Oedipe la première fois comme tu plonges dans l'eau froide, tu ne cherches pas à comprendre. Ta premièoe lecture est une lecture courbe, superficiel et rapide. Tu le lis en deux heures sans t'arrêter, en cherchant simplement à suivre le fil de l'histoire: Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et très vite, tu vas comprendre et tu vas être prise par l'histoire. Et à partir de là, tu peux t'amuser, t'offrir une deuxième lecture, tout aussi rapide que la première, mais beaucoup plus réfléchie, et puis petit à petit tu vas te faire de plus en plus intime avec la pièce qui est, comme les pièces de Shakespeare, ce qu'on a fait de plus beau au monde, c'est absolument magnifique. Et alors du point de vue du scénario tout est absolument sublime. |
|
J: Désolée de vous couper mais ces deux lectures, on ne nous laisse pas le temps de les faire, vous comprenez. On arrive en cours et on étudie plusieurs passages. Et voilà On ne nous fait pas découvrir l'oeuvre dans un autre contexte que les lectures méthodiques et l'épreuve orale. |
|
|
|
P: Il t'est arrivé de lire mes livres? |
|
J: Ben, en fait je les ai tous lus... |
|

|
P: [rires] et ben imagine que tu lises un Malaussène. Sauf que c'est pas un Malaussène; et tu t'y plonges avec autant de légèreté.Tu te flanques à l'ombre d'un arbre et tu te fais plaisir!! Ce qui vaut pour Sophocle est valable pour La Fontaine. Si tu dépasses le scolaire, si tu veux avoir «le plaisir de lectrice», c'est encore plus accessible avec La Fontaine car c'est très intelligent, c'est très méchant et il y a tout de suite une complicité avec le lecteur qu'il soit complice de ses sous-entendus, qu'il se marre avec lui. |
|
J: Et pour ce qui est des oeuvres modernes? Même si, comme vous l'avez dit toute oeuvre classique apporte du plaisir il ne faut pas oublier que les gens continuent d'écrire des livres avec lesquels on peut avoir autant de plaisir. |
|
|
|
P: Bon; pour ce qui est des oeuvres modernes, le lycée, le système scolaire ne doit pas t'empêcher de prendre du plaisir à les lire, au contraire! |
|
J: Oui, mais le problème c'est que des fois l'école nous dégoûte de la lecture. A force d'étudier des auteurs classiques on en vient parfois à penser que tous les livres sont aussi lourds, enfin je veux dire aussi difficile à lire. Alors que c'est pas vraiment le cas. |
|

|
P: Je pense que ce n'est pas vraiment le fait d'étudier des oeuvres classiques qui vous dégoûte de la lecture mais que c'est plutôt le fait qu'on vous les «saucissonne», qu'on coupe ça en morceaux et qu'on en arrive à faire de la chirurgie sur des bouts de cadavres. Alors il faut, pour arriver à être passionné de lecture, prendre du recul par rapport aux oeuvres étudiées en classe car ce qui va véritablement faire circuler les livres, ce sont les sentiments, tu vois. C'est la copine qui va te parler d'un livre, le petit copain, la tante, le cousin, etc. Ce n'est pas l'école, ça n'a jamais été l'école. Elle, elle apprend à lire et après c'est grâce aux sentiments, à l'affectif, si tu préfères, que le livre va circuler de main en main. Et les enfants vont avoir envie de lire à partir du moment où on va leur raconter des histoires le soir, c'est vraiment là que ça commence et c'est ça l'essentiel. |
|
|
|
|
|
P: Dans le domaine de l'enseignement t'as quoi, dix pour cent de gens séduisants, les autres ce sont, ce sont des gens normaux. Le rôle d'un prof n'est pas de vous séduire même si c'est formidable s'il y arrive mais c'est pas son métier. Ce qu'on lui demande, c'est de vous donner les moyens d'analyses critiques pour comprendre plus à fond ce que vous lisez. Alors il faut prendre ces moyens d'analyses pour ce qu'ils sont. Ils n'ont pas grand chose à voir avec la lecture gratuite que tu vas t'offrir quand tu seras en vacances. Voilà pour ta question... Bon c'est sûr que l'argument classique «on a pas assez de recul critique pour étudier une oeuvre moderne» est complètement idiot parce que n'importe qui peut s'offrir un recul critique avec le bouquin qui est sorti la semaine dernière. L'école, elle te fournit du savoir, elle te fournit des instruments d'analyses, mais elle n'est pas là pour te fournir du plaisir, on peut le regretter. |
|
J: Comment avez-vous découvert le plaisir de la lecture?
|
|
|
|
P: J'ai de la chance, mes parents s'intéressent à la littérature mais par exemple, mon père qui avait des parents étrangers et analphabètes a dû se débrouiller seul pour accéder au plaisir de la lecture. Beaucoup, n'ont pas d'aide extérieure et se détachent des lettres, des livres...
|
|
|
|

|
P: Mais parce que ça peut pas être institutionnalisé le plaisir. Quel ministre de l'éducation nationale va pouvoir décider que demain tous les profs vont être séduisants? Si dans ton cursus scolaire tu rencontres deux, trois profs qui te donnent envie d'étudier, tant mieux. Mais les autres, la grande majorité, il faut que tu t'en serves, c'est un peu cru; mais comme des vulgaires outils qui te permettent d'apprendre toujours plus.
|
|
J: Quel est votre point de vue sur l'enseignement de la philosophie? Pour ma part, je trouve ça un peu idiot de nous enseigner la philo juste en terminale avec, à la fin de l'année un coefficient sept au bac. Et vous qu'en pensez-vous? |
|
|
|
P: Ma réponse sera brève: je suis tout à fait d'accord avec toi. Il est totalement aberrant de n'enseigner la philo qu'un an. D'autant plus, que là encore, quand tu fréquenteras de petits enfants de cinq ou six ans, tu t'apercevras que les petits sont naturellement métaphysiciens, c'est-à-dire qu'ils posent des questions d'ordre métaphysique. Tout de suite, ils veulent savoir Dieu, l'univers, la mort, tout ça. Ensuite, vous les ados, vous continuez de façon très très naturelle à vous poser des questions d'ordre moral et psychologique. Le Bien, le Mal...Des choses qui font partie du programme philosophique en terminale. Donc ça, je n'ai jamais compris pourquoi une seule année et surtout le cofficient sept sur une seule année. |
|
|
|
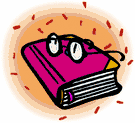
|
P: Je fais des ateliers avec des élèves qui ont de très très gros retards au niveau de la lecture et qui affirment une "détestation" du livre absolue. Alors, je fais des lectures, je fais jouer des piéces de théâtre à mes élèves, je fais apprendre un texte par coeur par semaine toute l'année. Ces textes sont numéroté de un à trente-deux et je demande un jour à Anaïs de me sortir le dix-sept. Et elle doit me sortir le dix-sept d'un coup, sans hésiter. Mais Anaïs a le droit ensuite de me demander le huit. Et à ce moment là dans la classe il y a une sorte de jeu inouï avec des duels: machin demande à truc le quatorze et l'autre il lui rétorque «à l'endroit ou à l'envers» et alors tu entends le Pont Mirabeau à l'envers. |
|
|
|

|
P: Alors tout d'abord, ce sont des textes qui leur plaisent, que je leur ai lus avant, dont on parle. Et puis la mémoire est un remède contre l'illétrisme, contre le dégoût de la lecture, car la mémoire, le souvenir de quelque chose que l'on a lu, c'est fabuleux. Leur faire apprendre un texte comme ça c'est pas pour les mécaniser, c'est parce que avoir un garde manger dans lequel on peut puiser, par jeu, et en riant, c'est magnifique. Mas cela suppose de la réciprocité. Cela suppose d'apprendre ce que tu fais apprendre. De toute façon, il y a une loi très importante que tous les profs devraient suivre, c'est qu'il n'y a pas d'enseignement efficace possible sans réciprocité. Il faut que l'enseignant s'implique. Par exemple, il est hors de question que Anaïs me rende un devoir si en même temps je ne lui rends pas le précédent corrigé. Ce sont pleins de petits trucs qui établissent une confiance entre le prof et les élèves. Alors donc pour l'illétrisme, il faut dédramatiser beaucoup, il faut jouer avec les lettres . Ce que je fais faire à mes élèves aussi c'est leur projeter au tableau des peintures surréalistes dans le style de Magritte ou encore de Dali et puis à partir de là je vais leur demander de noter tous les mots qui leur passent par la tête en regardant l'oeuvre. Tu ne penses à rien tu notes «rien». Et alors ils continuent «rien, nul, chier...» et puis au fur et à mesure ils commencent à sortir de leur tête des centaines de mots. Et ensuite quand tu relis avec eux tu t'aperçois que beaucoup ont écrit des mots sans en connaître le sens, mais ils sont là et là ils sont très contents de leur donner un sens. |
|
J: Et ben si tous les profs faisaient pareil, tout le monde étudierait sans difficulté jusqu'à l'agrégation!! Du côté de chez Pennac... J: Et pour parler un peu de vous, vous avez un prochain livre en projet?
|
|
|
|
P: Oui, cet été j'ai fait un feuilleton écrit pour le Nouvel Observateur, un Malaussène où Thérése tombe amoureuse.
|
|
J: Mais c'était pas fini Malaussène??! |
|
|
|
P: Ben si, mais je pouvais pas empêcher Thérése de tomber amoureuse |
|
J: Et à part les Malaussène, autre chose? |
|
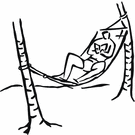
|
P: Quelques projets en tête mais je préfère ne pas en parler pour le moment. |
|
J: Sinon, vous êtes toujours enseignant ou vous avez arrêté? |
|
|
|
P: Je n'ai plus mes classes à moi car la directrice de mon école est partie et que j'ai passé l'âge de dresser les directeurs et donc je suis parti aussi. Mais du coup, je remplace mes heures de cours par des heures de visites dans les établissements où je fais tout le travail que je t'ai expliqué sur l'illétrisrne dans les écoles, les hôpitaux, les prisons, les maternelles... |
|
J: Et mêmes les lycées? |
|
|
|
P: Bien sûr (rires)
|
|
J: Et comment on fait pour vous avoir dans sa classe? |
|

|
P: Hé, hé, hé. Et bien la même démarche que pour une interview |
|
J: Et bien Daniel Pennac merci beaucoup de m'avoir accordé un peu de votre temps. |
|
|
|
P: Fais un bon papier
|
|
J: C'est très gentil à vous. Encore merci. Au revoir. |
|
|
|
P: Au revoir Anaïs! |
Anaïs
http://www.ac-grenoble.fr/lycee/3-sources/lycee/echarc1.htm