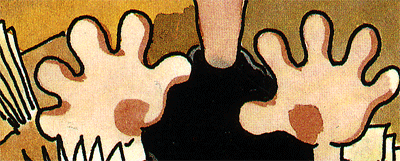grammaire
Nous avons déjà parlé des effets jouissifs produits par la manipulation des sons, de l’orthographe, des mots, comme dans le cas de Mondine et de ses fautes linguistiques. Et nous ne voudrions surtout pas oublier celles qui permettent de tourner le regard vers la grammaire:
- Il y aura du beau monde, faut que tu te tiennes. Je veux pas passer pour une quelconque, maintenant que tu m’as fait professeuse.
(Monsieur Malaussène, p.588)
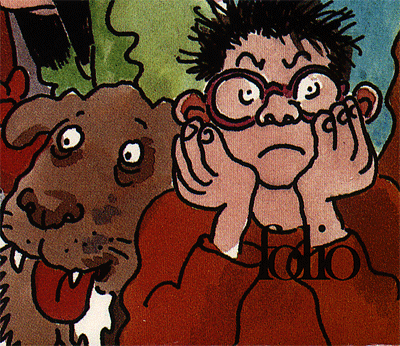
|
|
Pas de panique si vous êtes devant une telle éventualité. Dans tous les cas, essayez d’expliquer comme si vous racontiez une histoire (semble être la devise):
- Dis voir, Ben, est-ce que tu pourrais me dire pourquoi cette saloperie de participe passé s’accorde avec ce connard de COD quand il est placé avant cet enfoiré d’auxiliaire être?
- “Avoir”, Jérémy, devant l’auxiliaire “avoir”.
- Si tu préfères. Théo est pas foutu de m’expliquer.
- Moi, la mécanique... fait Théo avec un geste évasif.
Et j’explique, j’explique la bonne vieille règle en déposant un paternel baiser sur chaque front. C’est que, voyez-vous, jadis, le participe passé s’accordait avec le COD, que celui-ci fût placé avant ou après l’auxiliaire avoir. Mais les gens rataient si souvent l’accord quand il était placé après, que le législateur grammatical mua cette faute en règle. Voilà. C’est ainsi. Les langues évoluent dans le sens de la paresse. Oui, oui, “déplorable”.
(Au bonheur des ogres, p.157)
C’est que Ben est un conteur avant toute autre chose. Pour ses nombreux frères et sœurs, Ben apporte l’argent dans la famille, mais surtout les histoires. Qu’ils adorent. Le narrateur sort renforcé de cet échange puisqu’on ne peut pas s’empêcher de penser au plaisir qu’il en tire, et du même coup, en pédagogue réussi, il n’oublie jamais d’établir des rapports avec les connaissances déjà acquises par ses “apprenants”:
Ce n’était pas tout à fait faux, mais ce n’était pas vrai non plus.
- Comment ça?
Jouissance du narrateur...
- Eh! bien, c’était le genre de type à n’avoir jamais de chance. Il inventait vraiment des tas de trucs formidables (cocotte-minute, stylo-bille, genre...) mais toujours deux ou trois jours après qu’un autre les eut inventés (passé antérieur, Jérémy, et COD placé avant l’auxiliaire avoir).
(Au bonheur des ogres, p.194)
Vous connaissez, vous, beaucoup de profs capables de maintenir ainsi l’attention de l’auditoire autour de l’auxiliaire avoir? Parce que monsieur Pennac n’est jamais ennuyeux dans ces cas-là, au contraire. C’est vrai, parler grammaire sans assommer les autres relève parfois de l’exploit. Mais chez lui, cette réflexion, insérée dans l’histoire que le héros raconte, se revêt d’une grâce et d’une légèreté peu communes. Une légèreté et un plaisir qu’il essaie de transmettre. Comme preuve, ce monologue entre Ben et son futur bébé. Notre héros éprouve le besoin de bien expliquer au petit être à venir les moindres détails de sa nouvelle famille (et les plus petits plaisirs linguistiques, au passage):
|
|
On trouve donc chez notre auteur le bon vieux désir de jouer avec les catégories grammaticales tout en aiguisant sa critique, parfois acerbe. Nous n’avons retenu ici que certains cas relatifs à l’usage des personnes grammaticales et des temps verbaux. Voyons d’abord cette attaque contre les “gendelettres”, les auteurs prétentieux et vaniteux qui hantent apparemment toutes les maisons d’édition. La reine Zabo, éditrice de génie et son ami Loussa essayent de convaincre Ben de se faire passer pour un écrivain qui veut garder l’anonymat:
Un écrivain anonyme, en somme, comme un alcoolique repenti. L’idée me plaît assez. Les couloirs des Editions du Talion sont encombrés de premières personnes du singulier qui n’écrivent que pour devenir des troisièmes personnes publiques. Leur plume se fane et leur encre sèche dans le temps qu’ils perdent à courir les critiques et les maquilleuses. Ils sont gendelettres dès le premier éclair du premier flash et chopent des tics à force de poser de trois quarts pour la postérité. Ceux-là n’écrivent pas pour écrire, mais pour avoir écrit -et qu’on se le dise.
(La petite marchande de prose, p.114)
...tu m’excuseras Loussa, mais ce serait trop long à t’expliquer, trop fatigant.
C’est que, vois-tu, cette fois, je suis bel et bien occupé à mourir. Je sais, dit comme ça, à la première personne du singulier, c’est à n’y pas croire, et pourtant, à y bien réfléchir, c’est toujours à la première personne du singulier qu’on meurt pour de bon. Et c’est assez inacceptable, il faut le reconnaître. Les jeunes gens qui partent sans peur en croisades guerrières n’envoient que leur troisième personne sur les champs de bataille. A Berlin! Nach Paris! Allah Akhbar! C’est leur enthousiasme qu’ils envoient mourir à leur place, un tiers bourré d’une barbaque et d’un sang dont ils ignorent qu’ils sont les leurs. Ils meurent dans l’ignorance d’eux-mêmes, leur première personne confisquée par des idées tordues à face de Chabotte.
(La petite marchande de prose, p.303)

|
|
Eh oui, il n’est dit nulle part que les romanciers soient exempts de tels comportements... surtout si on leur vole du matériel littéraire:
... alors forcément, si on leur vole un mot... une ligne.... une œuvre... qu’aurait fait Dostoïesvski s’il avait trouvé l’Idiot sous une couverture de Turgueniev?... Flaubert si sa copine Collet lui avait fauché Emma? ils étaient de taille à massacrer leur monde ceux-là... ils écrivaient comme des assassins...
(La petite marchande de prose, p.323-4)
Cet écrivain-ci a fait preuve justement d’un petit problème avec l’usage des personnes grammaticales et des temps du récit. Heureusement, la reine Zabo veille sur lui:
- Je voulais compromettre Julie.
- Pour vous donner le rôle du sauveur en vous livrant après son arrestation?
- Oui.
- Écrivez-le. Et reprenons tout ça au présent de l’indicatif, si vous le voulez bien.
La reine l’avait aidé à mener à bien sa confession. Au présent de l’indicatif, qui était le temps de ses meurtres, et à la première personne du singulier qui était celle de l’assassin. Une centaine de pages, pas plus, mais les premières qui fussent de lui, qui fussent lui.
(La petite marchande de prose, p.365)
Parlons-en donc de ces fameux temps et modes verbaux, moins dans la perspective pédagogique déjà signalée que dans une perspective métaphorique. Vous ne l’avez peut-être pas remarqué mais un temps verbal peut devenir une arme dangereuse. Ben a été accusé (à tort évidemment) de meurtre. Remarquez le champ sémantique de la violence lorsque la presse s’attaque à lui avec le conditionnel:
Non, non, non, pas un mot sur mon procès. Reportez-vous à votre journal habituel. C’est lui qui a tiré le premier, d’ailleurs. La préparation d’artillerie de la presse... Ce bombardement continu des journaux contre les remparts de ma défense... Les obus chargés au conditionnel pour qu’ils ne risquent pas de péter à la gueule des canonniers. Il paraît que ce Malaussène (photo) et sa “diabolique” compagne (photo) auraient fait exploser une maison et tous ses habitants. Il paraît que la vengeance ne serait pas leur principal mobile mais le vol. Il semblerait qu’ils aient éliminé une jeune soubrette (photo, c’est bien elle, la pauvre) et un jeune étudiant (photo de Clément, hélas!), deux témoins gênants. Il paraît qu’on lui aurait, à lui, Malaussène, greffé les organes d’un tueur en série (photo de Krämer) et que ça l’aurait rendu complètement dingue.
(Monsieur Malaussène, p.492)
|
|
|
|
|
- Mais c'est Benjamin notre papa. C'est Benjamin, et c'est Amar, aussi. Et c'est Théo. Allez, mange ta soupe, le Petit.
- Je préférerais mon papa, répondit le Petit sans toucher à son potage.
Ce conditionnel présent hanta ma nuit.
Je préférerais.
Le Petit avait bien dit: "Je préférerais mon papa."
J'ignorais que le mode d'un verbe pût vous glacer le sang. Ce fut bel et bien le cas. Pour une raison que je ne parvenais pas à m'expliquer, ce conditionnel présent emprisonna ma nuit dans un sarcophage de terreur. (Métaphore lamentable, je sais, mais je n'étais pas en état d'en trouver une meilleure.)
On aime bien cette instance narrative qui émerge. Elle nous rappelle que derrière Ben se cache un auteur qui se plaît à attirer notre attention sur le fait même d’écrire, de raconter des histoires. Un romancier qui place l’écriture devant un miroir et crée, en définitive, la fiction de lever le voile sur ce moment intime du créateur à la recherche de l’expression juste. Et qui veut bien sourire avec nous de la métaphore. Mais s’il prétend qu’elle est “lamentable” c’est pour nous servir juste après une excellente image sur ce “conditionnel intraitable”. En effet, ce ne sera pas la dernière fois que Ben devra affronter ce temps verbal. Aux Editions du Talion la reine Zabo lui confie la tâche de demander à un auteur de changer pratiquement tout son manuscrit:
- Je préférerais n'en rien faire.
Encore ce conditionnel présent! Le même que celui du Petit. Un conditionnel intraitable. Un impératif de politesse, en fait. Mais un impératif catégorique.
Ce type ne toucherait pas un seul mot de son texte.
|
Une lecture! Voilà d'où me venait ma hantise du mode conditionnel. D'une lecture que j'avais faite! Une lecture, un jour, et le virus du conditionnel dans le sang.(...) Une fois dans la bibliothèque, il me fallut environ deux secondes pour mettre la main sur le Bartleby de Melville. Barthleby! Herman Melville, Bartleby, parfaitement. Qui a lu cette longue nouvelle sait de quelle terreur peut se charger le mode conditionnel. Qui la lira saura.
Le “poison” de la lecture prend ici tout son sens. Vous n’aviez jamais imaginé une telle terreur? Dans votre vie de tous les jours vous n’avez jamais affronté une telle angoisse? Eh bien, les récits nous apprennent ça aussi:
-J'aimerais mieux pas.
I would prefer not to. Tout en lisant, je me surpris à traduire en anglais la revendication du Petit. Tant qu'il était resté sur la terre ferme du mode indicatif: "Je veux mon papa...I want my daddy", Je ne m'étais pas inquiété, j'y avais même vu une invite à l'aimable rigolade. Les choses s'étaient gâtées quand le petit avait troqué le verbe vouloir contre le verbe préférer et cet indicatif de bon aloi contre ce conditionnel retors, "je préférerais mon papa". "I would prefer my daddy." (...) aucun doute, le Petit était atteint de bartlebisme. Et les lecteurs de Bartleby savent à quelle extrémité peut conduire cette affection!
(Des chrétiens et des maures, p.15-21)
Et voilà un temps verbal qui vire sous nos yeux à la pathologie, qui est capable de la transmettre plutôt. Personnification de temps verbal, ça devrait exister comme figure. En tout cas, les modes verbaux se revêtent indéniablement de caractéristiques animées.
|

|
Certains éléments grammaticaux se transforment ainsi sous nos yeux en matériel romanesque hautement productif. Vous verrez d’ailleurs dans l’exercice ci-dessous comment se crée un nouveau temps verbal pour les besoins de l’histoire. Une vraie trouvaille! Qui avait dit que parler grammaire ne pouvait être qu’assommant? Mais pas du tout... Chez Daniel Pennac au moins les résultats sont surprenants et pleins d’humour. Dans un bel exemple d’hommage à la langue, l’auteur se plaît en jouant avec eux, en jouant avec nous.
Vous ne connaissez sans doute pas le “plus-que-présent”. Je me trompe? Benjamin Malaussène nous en parle lorsqu’il est injustement emprisonné par le commissaire divisionnaire Legendre.
Lisez attentivement cette petite merveille et répondez aux questions:
|
1 - “Un éducateur-né” Expliquez comment fonctionne l’ironie dans la caractérisation du personnage de Faucigny (“rendre tout son indicatif au présent”; “Monsieur Météo”...)
2 - Pourquoi la phrase “Je vais vous guérir, Malaussène...” fait tellement peur? Comment a fait l’auteur? Quel est le rapport avec le “plus-que-présent”?
3- Dernier paragraphe. Montrez comment les références temporelles et les analogies utilisées s’apparentent à la torture (confusion temporelle du début, modificateurs temporels “perpétuel”, “sans fin”, “sans bout”...; champ sémantique: “regret”, “remords”, “agonie”, “ mort”...)