regard sur le récit
Vous connaissez sans doute ces poupées russes qui s’enchâssent les unes dans les autres. Daniel Pennac emploie le terme de “gigogne” (comme pour les tables) pour traduire cette mise en abîme, cette construction complexe et riche qu’est son roman Le dictateur et le hamac:
Ce serait l’histoire d’un dictateur agoraphobe qui se ferait remplacer par un sosie.
Ce serait l’histoire de ce sosie qui se ferait à son tour remplacer par un sosie.
Mais c’est surtout l’histoire de l’auteur rêvant à cela dans son hamac.
Et c’est l’éloge du hamac: ce rectangle de temps suspendu dans le ciel.

|
|
Parce qu’on voit se former les personnages mêmes. À commencer par ce lamentable dictateur, Manuel Pereira da Ponte Martins qui semble s’agripper au récit, comme à sa vie:
Voilà. L'histoire pourrait s'arrêter ici, car Pereira mourut exactement comme dans son rêve. Selement, comme tout homme digne de récit, il voulut échapper à son destin. Et toute l'histoire de Pereira est celle de cette tentative.
C'est cette histoire-là qui mériterait d'être racontée.
(Le dictateur et le hamac, p.26)
Tandis que l’on apprend cette histoire de dictateurs, les souvenirs personnels de l’auteur entrent en collision avec ce dessin “in vivo” des personnages, de telle façon que le matériel narratif gagne une indépendance à laquelle on ne croyait qu’à demi. Mais l’auteur sait très bien tracer les différents prêts, les emprunts, les vases communiquants en somme, entre vécu et fiction. La meilleure preuve en est le personnage de Sonia, qui s’enrichit d’un souvenir d’une amie de l’auteur. Elle arrive à “survivre”, pas contre la volonté de l’auteur, non, mais un peu à l’improviste:
|
On a la sensation de voir derrière le miroir... C’est peut-être l’œuvre de Pennac qui mise le plus à fond sur le jeu des regards, sur les récits qui se réfléchissent en donnant la possibilité de créer une multiplicité de plans, les uns différents aux autres mais sans doute enrichissant le tout. C’est une image qui ne cesse de le hanter:
À y repenser aujourd'hui, la multiplication du pape sur les écrans de télévision (qui n'entraîna pas celle des petits pains), et plus généralement la duplication tous azimuts dont nous gave notre culture de l'image, n'est pas pour rien dans cette histoire de sosies gigognes. Un monde pareil à la Vache qui rit, voilà le rêve de nos "communicants". Nous tous mis en abîme...
(Le dictateur et le hamac, p.108)
Nous avons déjà souligné les effets humoristiques produits par le regard sur les images, par exemple. Lorsque ce regard se porte sur l’ensemble du récit, il se produit à nouveau un détachement drôle et intelligent. Et dans ce cas-là, plus que jamais, l’auteur se plaît à jouer avec l’effet de vraisemblance, avec notre souci de réalisme et des convenances.
|
|

|
Dans Monsieur Malaussène, Jérémy est en train de devenir romancier, épaulé par la patronne de Ben, la reine Zabo. C’est une façon de plaider pour son frère, accusé des pires crimes (”Il utilise les mois qui passent à me tricoter une apologie qui me tiendra chaud pendant ma perpète”). Or, voilà le schéma général qu’il présente à son frère aîné:
- Ça fera quatre bouquins en tout. Un pour les bombes du Magasin, un pour les grands-pères toxicos de Belleville, un troisième pour ton coma dépassé, et le dernier pour ce qui t’arrive maintenant. Je ne les écris pas l’un après l’autre, j’écris tout ensemble, comme ça me vient. Un peu comme on fait les films, tu vois? On tourne la séquence de son choix, en fonction de la météo ou des coquelicots de madame la star, et on met le tout en ordre au montage. Qu’est-ce que tu en penses, Ben?
J’en pense que la reine Zabo ne doit pas être loin derrière.
(Monsieur Malaussène, p.477-78)
Nous, lecteurs fidèles de Daniel Pennac, nous savons que cela correspond exactement aux quatre premiers romans sur la Saga des Malaussène, initiée avec Au bonheur des ogres. L’auteur laisse ainsi le personnage s’approprier le copyright de son œuvre et prendre de grands airs d’écrivain. Ce clin d’œil “paternel” vise évidemment à nous faire sourire, à nous rendre complices des prétentions du jeune narrateur.
Mais l’effet de vraisemblance ne chancelle pas comme dans la citation suivante. Ben continue le monologue avec son futur bébé et laisse échapper au beau milieu de ses souvenirs une référence explicite à leur condition de personnages littéraires:
Julie, ta propre mère, a failli y passer dans cette histoire; on a essayé de la noyer, on lui a brûlé la peau avec des cigarettes, on t’a fabriqué une mère léopard. Au volume suivant on me collait une balle dans la tête. Oui, mon enfant, ton père sonne creux: une fontanelle d’acier et le doute par dessous.
(Monsieur Malaussène, p.33-4)
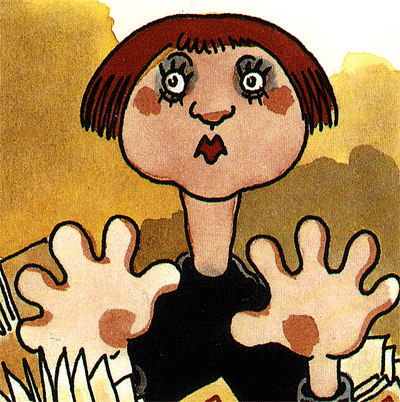
|
|
|
|
Un effet comique au plus haut point puisque le nom même de l’auteur devient sujet de controverse entre son narrateur et Julie:
...ta mère et moi, nous utilisions le peu de souffle qu’il nous restait à choisir ton prénom dans les catalogues disponibles. (...) ... mais c’est plus fort que moi, dès que j’entends prononcer le nom d’un martyr, je ne peux m’empêcher de revivre en détail les circonstances qui l’ont enlevé à notre affection.(...)
- Etienne... moi j‘aime beaucoup Etienne. Un prénom à diphtongue...c’est doux.
- Lapidé sur la route à Jérusalem. Le premier martyr. Il inaugurait. Tu as une idée de ce que ça représente, la lapidation? Quand le crâne éclate, par exemple... Pourquoi pas Sébastien, tant que tu y es? J’entends déjà siffler les flèches et je vois les peintres déplier leur chevalet... Non, Julie, cherche plutôt du côté des prophètes ou des patriarches, ils ont su se placer dans le temps, eux, ils annonçaient les catastrophes, ils ne les subissaient pas...enfin, moins.
- Isaac?
- Pour que le Grand Parano m’ordonne de le lui réexpédier à coups de canif? Pas question.
- Job?
- Déjà pris.
- Daniel... Le Babylonien...!
Là, il s’est passé quelque chose d’étrange, que je ne peux absolument pas expliquer. J’ai pâli, je crois, j’ai senti la soudure gripper tous mes rouages, un grand vent glacé a momifié le reste, et, d’une voix sans timbre, j’ai murmuré:
- Non!
- Non? pourquoi, non? Les lions, il les a domptés, lui!
Sans bouger un cil, j’ai dit:
- Pas de Daniel dans la famille, Julie, jamais, jure-le-moi. Un seul Daniel et tous les emmerdements du monde nous tomberont sur la gueule, je le sens, je le sais.
(Monsieur Malaussène, p.109)
|
|
L’humour qui naît de cet effort satisfait pleinement notre besoin de construire le sens de l’histoire avec l’auteur. Le lecteur se sent sans doute plus intelligent lorsqu’il participe d’une certaine façon au récit, lorsqu’il doit combler les vides d’information, et surtout, lorsque l’auteur l’interpelle directement pour en faire le premier témoin de son récit. Mais attention, ce témoin se doit d’être bien attentif, l’auteur l’exige. Observez l’exemple suivant du 14e chapitre d’Au bonheur des ogres:
Je reçois le coup de plein flanc. Pas le temps de reprendre mon souffle qu’une autre attaque, frontale, cette fois, m’envoie au tapis. Je n’ai plus qu’à me mettre en boule, me rassembler au maximum, laisser pleuvoir, attendre que ça passe tout en sachant que ça ne passera pas. Et ça ne passe pas. Ça me tombe dessus de tous les côtés à la fois. L’image qui me vient alors est celle de ces marins américains dont le bateau s’est fait couler quelque part dans le Pacifique, vers la fin de la guerre. Les hommes à la mer s’étaient agglutinés, pour faire bloc, et flottaient en se tenant les coudes, comme une immense flaque humaine. Les requins avaient attaqué cette galette en commençant par les bords, grignotant, grignotant jusqu’au cœur.
C’est exactement ce que Stojil est en train de me faire. Il a repoussé mes forces autour de mon roi et attaque de tous les côtés à la fois.(Au bonheur des ogres , p.88)
D’accord, l’auteur nous a mis en quelque sorte un piège et ce n’est que vers la fin que l’on se rend vraiment compte du sujet: il s’agit d’une partie d‘échecs élevée à la puissance de la métaphore. Eh bien, voici le début du chapitre 21:
|
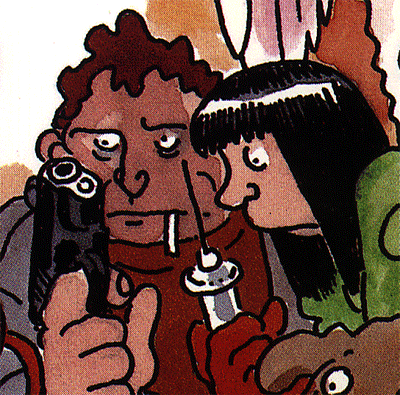
|
Vous vous étiez un peu endormis? Moi j’avoue, c’était mon cas, et je croyais évidemment avoir affaire à une autre partie d’échecs avec dure image alimentaire en plus.
Mais non, l’auteur se marre ouvertement de nos capacités d’anticipation, crée un parallélisme entre les deux chapitres et nous détourne habilement de nos prévisions. Voilà la surprise, mais en plus il nous interpelle (nous crie, plutôt)... un peu d’attention, s’il vous plaît, mon cher lecteur...
Il existe en ce sens un procédé que Pennac apprécie particulièrement, la figure de “prétérition” qui consiste à dire quelque chose en affirmant qu'on ne veut/peut pas le dire. On l’a brièvement vu lorsqu’on parlait du conditionnel belliqueux (”Non, non, non, pas un mot sur mon procès”). Cela permet aussi de diriger le regard vers la construction même de l’histoire d’une façon légère, tout en jouant avec l’attention du lecteur. Le narrateur insiste:
Non, non, non, on ne raconte pas son propre procès. Raconte-t-on son agonie? On enregistre deux ou trois impressions, tout au plus. On s’engourdit au fil des audiences, on sent son innocence filer comme la vie d’un suicidé dans la chaleur de son bain. On consent vaguement à cette perte, à la multiplicité, à l’originalité des coups portés par la partie adverse.
J’entends encore la première question de maître Gervier. Une question gourmande, d’entrée de jeu...
(Monsieur Malaussène, p.496)
Et en avant avec les détails du procès... Mais ce qui ajoute du piment à la figure, c’est l’allusion à l’agonie. Parce que le lecteur averti sait bien que ce même narrateur nous avait raconté justement son agonie dans le volume antérieur:
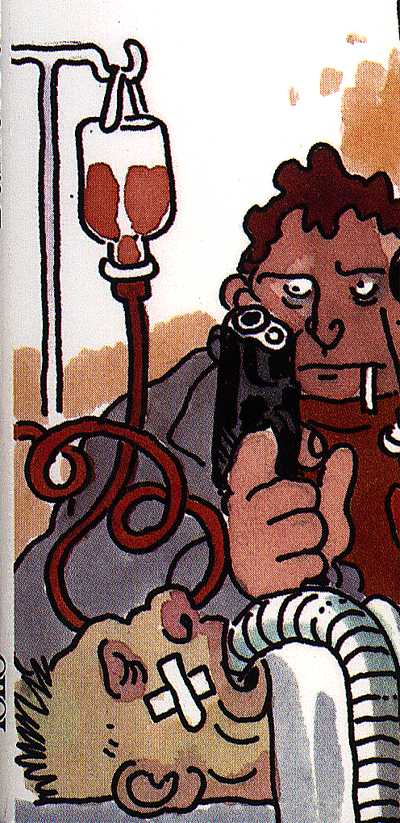
|
|
Et cela nous faisait quand même sourire... C’est ce qui explique cette connivence réussie avec l’auteur, cette acceptation du jeu qui finit avec une nouvelle interpellation, une fois que Benjamin Malaussène a bel et bien fini par détailler son procès pour tous les crimes imaginables (et imaginés).
Voici la fin du chapitre:
Et vous voudriez vraiment que je vous raconte mon procès?
(Monsieur Malaussène, p.507)
Il faut tout de même dire que cette connivence est durement mise à l’épreuve. Parce que le lecteur est très sérieusement défié par le narrateur. Celui-ci va lui rejeter à la figure les objections à la vraisemblance qu’il ne va pas tarder à émettre. C’est comme ça, l’auteur ne se laisse pas juger par notre souci du réalisme et des convenances. Et un sérieux dialogue s’établit. Quand il proposait l’image de la Vache qui rit (nous tous mis en abîme...), cela comprenait le lecteur aussi...
|
...Et puisque, patate et couteau à la main, Igor joue son rôle de grand, il en profite pour donner à Tatiana sa séance de thérapie quotidienne.
- Justement, maman, c’est ça qui déconne. Tu cherches un type qui serait le jumeau de papa. Et comme tu ne trouves pas, tu prends n’importe qui, tu tapes dans le contraire, tu te fais un mal terrible...
Non, non, la question n’est pas de savoir s’il est “convenable” de laisser un gamin de douze ans et quelques juger de la sexualité de sa mère, ni s’il est “réaliste” que le même mouflet s’offre une incursion dans la chasse gardée de la psychologie adulte. Dix-sept mois maintenant que nous sommes au-delà du désespoir dans cette famille, alors ne nous faites pas chier avec le convenable et laissez la réalité juger du réalisme! Est-il convenable qu’un type de trente-huit ans franchisse à peu près sain les portes d’un hôpital et en ressorte contaminé jusqu’à l’os par ceux-là mêmes qui devaient se contenter de lui ôter les amygdales? (Les amygdales à trente-huit ans, parfaitement! Ça arrive. Et, quand on s’y prend comme un boucher, ça saigne!) J’aurais beaucoup à dire sur la mort et le bon goût! Quant au réalisme... Le réalisme est la seule considération qui ait empêché Igor Laforgue -à peine onze ans à l’époque- d’aller ouvrir le ventre du chirurgien transfuseur qui venait de le faire orphelin, avec une mère à charge et un Everest de chagrin à gravir. Il avait même songé à utiliser un bistouri, Igor, si vous voulez tout savoir. Il ne mesurait qu’un mètre trente-deux et avait monté son coup au quart de poil. Il avait calculé le jour, l‘heure, le moment. Il ne pesait que trente-trois kilos et s'était procuré le bistouri en question. Et puis il avait renoncé à couper le chirurgien en deux, au nom du réalisme, justement, en parlant avec Joseph, parce que, au-delà du chirurgien, d’après Joseph qui le tenait de son cousin Rabbi Razon, le rabbin de la rue Vieille-du-Temple, si on ouvrait le chirurgien il faudrait étriper la hiérarchie hospitalière tout entière, et de l’hospitalier passer au politique, et du politique à tous les salopards de la chimie industrielle... et qu’à onze ans, un mètre trente-deux et trente-trois kilogrammes, c’est une tâche dont l’inefficacité rebute... sans parler de Tatiana, du chagrin qui se serait posé sur le chagrin de Tatiana.
Alors foutez-nous la paix avec les convenances et le réalisme, et revenons à ce qui se dit dans cette cuisine, la nuit d’hiver maintenant tombée sur Paris et Igor jouant du presse-purée.
Ouff... c’est dur comme histoire. On sent que les larmes ne vont pas tarder à inonder tout le récit. Et pourtant l’auteur nous arrache à nouveau le sourire.
|
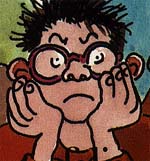
|
Interruption du dialogue avec le lecteur, puis, hop, suivez-moi. Et on suit. On suit même lorsque l’éprouvante scène mère-fils se termine par les pleurs sur l’absent. C’est alors que le narrateur revient à la charge et ironise sur notre nécessité de réalisme:
Igor sanglote maintenant dans les bras de Tatiana. Un enfant pleure dans les bras de sa mère.
- Je ne veux pas grandir maman, je suis déjà trop grand...
Dieu soit loué, il pleure sur des phrases de son âge: c’est la victoire des convenances et du réalisme. Tout est dans l’ordre, on peut tourner la page et passer chez les Kader.
(Messieurs les enfants, p.41-43)
Il faut dire que Daniel Pennac sait justement transcrire avec un réalisme percutant l’univers des enfants et des adolescents (nous l’avons esquissé en parlant des jeux de sons). On décèle chez lui un souci tout particulier pour ne pas trahir la “vérité” d’un tel personnage. Nous avons un excellent exemple dans Messieurs les enfants. Roman qui se présente comme une véritable mise en abîme du devoir de français, version Crastaing (l’imagination, ce n’est pas le mensonge). Avec un humour très fin, l’auteur observe le problème du côté de Joseph. Il cherche anxieusement de l’aide pour cette fameuse rédaction:
Ce qui complique tout, c’est que la plupart des enfants font les enfants, et que presque tous les adultes jouent aux adultes. C’est très difficile à évaluer, l’âge. Tu comprends?
Joseph comprend parfaitement que Crastaing trouvera ça insuffisant -en rouge, dans la marge. Joseph avance un autre pion. Il explique à cousin Samuel que par certains côtés, lui, Joseph, trouve que Moune n’a pas changé depuis ses premières photos et que Pope, “mais est-ce que j’ai le droit de dire ça de mon propre père?”, est encore un enfant, surtout quand il m’engueule, “parce qu’il m’engueule quand il a peur, vous comprenez? C’est quand il a très peur qu’il me gronde... Comme un enfant!”
Nouveau silence de Rabbi Razon.
Assez long, cette fois.
- Tu n’es pas bête du tout, mon petit Joseph. Et le respect, tu l’as. Et l’intelligence aussi. Tu viens de comprendre quelque chose d’essentiel.
... Il y a des moments dans la vie où on donnerait n’importe quoi pour savoir ce qu’on vient de comprendre d’essentiel.
(Messieurs les enfants, p.59)
Et que dire des tableaux de groupe? Voici les enfants transformés en grandes personnes et les parents redevenus enfants:

|
|
Ce n’est pas réaliste ça, madame? Comme la vie de tous les jours...
Mais ne nous écartons pas de ce regard sur le récit, de cette réflexion sur la construction de l’histoire et notre sempiternel besoin de cohérence. On voudrait finir avec un exercice en ce sens. L’auteur nous “malmène” davantage parce qu’ici ce n’est pas d’un débat ponctuel dont on parle. On parle de huit chapitres pendant lesquels l’auteur nous a menés en bateau. Abus de confiance? Carrément. On n’a pas d’autres mots. Lui non plus d’ailleurs, vous allez l’écouter.
Que je vous explique un peu avant. On est tellement habitués à voir Benjamin accusé à tort, et à le voir s’en sortir des pires situations, que dans Monsieur Malaussène nous tombons directement dans le panneau. On ne sait pas comment l’auteur va le tirer de cette condamnation à perpète (30 ans incompressibles). On en est encore à attendre lorsque... surprise, on nous annonce que nous venons de lire (le long de 8 chapitres!) le roman que Jérémy a brodé sur la “réalité”, pas la “véritable” histoire de Benjamin (humm...)
Cette extraordinaire liberté dans le récit provoque un léger effet de réel dans la fiction lorsque le public de Jérémy, ses frères et sœurs, ne semble pas apprécier le procédé littéraire. Voici Thérèse:
Tu peux dire ce que tu veux, mais symboliquement parlant, c’est très suspect que tu fasses ça à ton frère aîné.
- Mais je ne lui fais rien, putain de merde, je raconte! Tu es quand même foutue de faire la différence, non?
(Monsieur Malaussène, p.518)
|
|
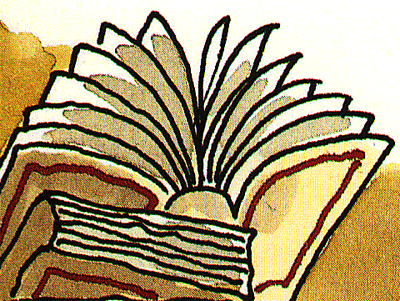
|
Dis moi, Ben, le procès, le verdict, on y croit vraiment?
- J’y ai presque cru moi-même.
- Et toi, tu te trouves ressemblant, toi?
- On ne se connaît jamais vraiment, tu sais, mais j’ai l’impression que tu ne m’as pas raté...
(Monsieur Malaussène, 521)
Oui, enfin, nous on y avait cru dur comme fer, un peu dans le style de la phrase qui ouvre le chapitre XII, “Une erreur judiciaire est toujours un chef d’œuvre de cohérence”. Écoutons donc le narrateur nous proposer des explications et nous accuser aussi, nous, ses fidèles lecteurs (“ceux-là mêmes qui sont les mieux avertis de mon innocence”). Nous sommes impardonnables...
exercice
|
1- Le narrateur reconnaît ses griefs. Mais accuse aussi le lecteur. Quelles sont les deux accusations majeures? Analyse du type de phrase.
2- Analyse du registre de langue. Comment cela se fait que l’usage d’un langage cru aide à blanchir la décision prise par le narrateur?
3- L’effet humoristique: quelle attitude endosse le narrateur face au lecteur?