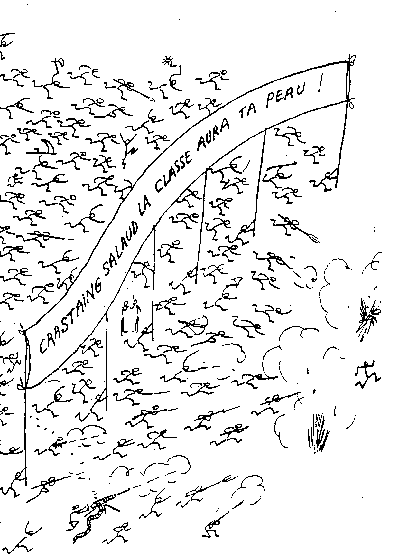arrêt sur image
Daniel Pennac aime bien souligner ses trouvailles linguistiques tout en réalisant des commentaires sur leur nature même. Il s’exerce donc à un jeu metalittéraire avec un lecteur qu’il prend à témoin et qui est invité à savourer l’image surprenante. Cet écart, cette distance qui s’installe entre le récit et la narration, tend à créer une complicité supplémentaire. On dirait que le narrateur se situe à notre niveau et prévoit les objections que pourrait réaliser un lecteur (trop?) soucieux. Il fait ressortir ainsi l’image, la juge, et souvent il arrive même à la trouver déplacée, ce qui a pour effet de la focaliser en augmentant son pouvoir décapant.
 |
|
Ta grand-mère n’est pas seulement une femme, ta grand-mère ne se contente pas non plus d’être une apparition, ta grand-mère est l’apparition de la femme. (Ça paraît con à dire comme ça, mais quand tu la verras, tu comprendras que le langage a ses limites.)
(Monsieur Malaussène, p.31)
Ah, les femmes... les femmes aimées de Benjamin Malaussène surtout. Une petite galerie de femmes attirantes, séduisantes, à commencer par les membres de sa propre famille avec lesquelles, on a pu s’en apercevoir, Ben établit des rapports étroits. Et si la mère est normalement absente de Belleville, sa sœur Clara s’impose parfois comme le havre de paix que le héros recherche (et qu’il doit aussi parfois éviter au risque de...). Clara à la voix de velours... non non, pas de velours, écoutons plutôt Ben à propos de sa sœur bien aimée:
-Allô?
-Ben?
(Clara! Clara, c’est toi, ma Clarinette! Pourquoi donc aimé-je tant ta voix, me lover dans ta paisible petite voix, sans jamais un accroc, ton doux tapis de billard où roule la précision de tes mots... Bon ça va, Benjamin, n’inceste pas! Et puis, se lover dans un tapis de billard...)
(Au bonheur des ogres, p.140)
|
Je pleurais depuis longtemps quand je me suis réveillé.
- Ce n’est rien, Benjamin, murmurait Julie à mon oreille, c’est une petite déprime.
Je pleurais à gros sanglots dans les frondaisons de Julie.
- Il y a des tas de bonnes raisons pour faire une déprime.
Elle me berçait.
- Passer de la taule au bonheur, par exemple.
Elle m’expliquait le phénomène.
- C’est la pororoca, Benjamin, la rencontre du fleuve Amazone et de l’Océan Atlantique, la collision des sentiments... un raz de marée épouvantable, un boucan inouï!
Je m‘accrochais désespérément à ses branches.
- Tu veux que je te raconte ma plus jolie déprime?
Je me suis endormi une deuxième fois, dans le récit de sa pororoca personnelle.
- C’était le lendemain de notre rencontre, Benjamin. Je ne t’ai pas revu pendant des semaines, tu te souviens? Des semaines de pororoca... Ma liberté se cabrait contre mon bonheur. J’ai beaucoup pleuré, beaucoup baisé, beaucoup cassé... et puis tu es venu me chercher... tu as forcé le barrage... tu es remonté jusqu’à ma source... très heureuse, je suis devenue...
Elle riait en silence. Je l’entendais de très loin.
- Très heureuse et très conne...
La reine Zabo censurerait cette métaphore de l’Amazone et de l’Atlantique si elle la trouvait sous la plume de Jérémy. Je l’entends d’ici: “Ce mélange des eaux, mon garçon, c’est de la métaphore saumâtre!”.
(Monsieur Malaussène, p.570)
|

|
C’est précisément ce regard qui nous fait sortir de l’histoire au cas où un excès de fibre sensible nous semblerait un tantinet mièvre. Très intelligent pour parer à notre scepticisme sur la vraisemblance du récit. Et jouissif. Et beau.
C’est curieux, on aurait dit que le sens de l’humour que véhicule ce regard sur l’image nous écarterait de l’histoire. Du moment qu’il nous permettrait un éloignement salutaire... oui, et dans un sens c’est vrai. Mais il n’est pas moins évident que le second effet de ce regard est de nous maintenir attachés à l’histoire. On fait de nous des complices. Des complices de la narration. On a prévu nos objections sur la vraisemblance ou l’opportunité de l’image. Il y avait un risque. Or, le résultat ne nous déplaît pas, au contraire. On refait donc confiance à l’auteur. On continue dans l’histoire.
Et si dans ce cas-là le regard limite les dégâts d’une hypothétique sensiblerie, si on affirme trouver la figure un peu déplacée, parfois, c’est le contraire. On voit alors le narrateur s’accrocher à son image et la défendre contre vents et marées. Après l’usage que Le Petit avait fait du conditionnel intraitable (grammaire), Ben s’est souvenu de Barthleby. Il en a fait une métaphore:
Là, j'ai perdu patience.(...)
Et tant que j'y étais, j'ajoutai que je n'étais pas moi-même atteint de bovarysme, que je savais parfaitement faire le départ entre ce qui relevait de la littérature et ce qui ressortissait à la pathologie, que Bartleby, en l'occurrence, ne jouait ici que le rôle d'une métaphore, mais lumineuse comme une fusée de détresse.
- Je te parle de mon plus jeune frère qui me fait une grève de la faim!
(Des chrétiens et des maures, p.24)
Et il n’est pas rare qu’il mette en scène la création même de l’image. Le narrateur prend ainsi le lecteur à témoin sur cette construction littéraire tandis que celle-ci semble prendre forme sous leurs yeux. Bel effet de miroir.

|
|
Ces effets métalittéraires tendent souvent à préciser le goût de notre auteur pour les jeux de dédoublement. Personnages littéraires qui deviennent métaphores d’un nouveau récit, personnages-narrateurs qui jugent les images que nous sommes en train de lire, narrateurs qui regardent en quelque sorte notre regard sur un texte dont ils sont les héros... Jeux de miroirs et mises en abîme que nous approfondirons lorsque nous parlerons du regard sur le récit. Mais pour l’instant, je vous offre un bel exemple d’image auto-réfléchissante. Nous assistons au procès de Ben pour un bon nombre d’assassinats. Un procès télévisé. Nous, on le sait, il est l’innocence même (l'innocence m'aime). Or, on s’y attendait aussi, l’accusation n’est pas de notre avis:
- Votre client est un effaceur de vies.
Plan fixe sur l’”effaceur de vies” dont le regard est hypnotisé par un écran moniteur. C’est la première fois que je me vois à la télé. C’est moi, là, en face de moi. Deux gendarmes à mes côtés, qui regardent droit devant eux, puis -zoom- moi tout seul, en plan rapproché -et rezoom!- toujours moi, en gros plan, perdu dans la contemplation de moi.
- Un effaceur de vies qui ne déteste pas son image, conclut maître Bronlard.
Cette petite phrase met un certain temps à traverser ma stupeur avant d’exploser dans mon cerveau. Quand je relève la tête, ils sont tous occupés à me regarder. A me regarder me regardant.
(Monsieur Malaussène, p.501)
Cela fait froid dans le dos, n’est-ce pas? Oui, certaines images sont très puissantes...
Je vous propose de finir avec un extrait qui nous replonge dans la fiction de l’auteur à l’ouvroir. Dans Messieurs les enfants, le narrateur feint à un certain moment de chercher avec nous la couleur exacte d’une image. Mais pour nous, lecteurs, l’histoire se complique du fait que nous croyions avoir affaire à un narrateur extra-diégétique et voilà que l’on n’est plus si sûrs...
exercice
|
|
|
|
Oui, ça peut paraître bête à dire comme ça, mais si vous lisez, vous verrez, vous sentirez même, que l’imagination ce n’est pas le mensonge. D’où tout l’art de Daniel Pennac. Parce que je vous assure que notre goût pour le vraisemblable, le réalisme et les convenances n’est pas trahi, et cela malgré les risques pris (ou justement grâce aux risques). On y croit, bon sang! On voit et on sent la peur de Joseph derrière la porte de ses parents. Joseph qui craint de tout son corps ce qu’il va découvrir, et qui s’attend déjà au pire:
Joseph debout devant la porte de ses parents.
La caisse de résonance de sa poitrine.
La main de Joseph autour de la poignée.
Joseph et la poignée de porcelaine... de porcelaine baguée de cuivre... Ne faire aucun bruit en tournant cette poignée, absolument aucun... Comment décrire ce luxe de précautions? Le geste chirurgical, peut-être?
Arrêter le tintamarre de son cœur, d’abord.
L’intense concentration du démineur, plutôt... Seulement, j’ai déjà utilisé cette image plus haut, quand Igor introduit sa clef dans notre serrure. (Quand je dis “notre” serrure...) À cela près qu’Igor mimait la prudence alors qu’ici Joseph en est l’incarnation... Oui, la voilà l’image: la pince du démineur qui hésite entre les deux fils... celui-ci? celui-là? le rouge? le jaune? S’il se trompe, il saute -et le cinéma avec lui, à en juger par le silence de la salle.
Mais il faut bien que le démineur choisisse et que Joseph ouvre cette porte. Ce qu’ils finissent par faire, l’un comme l’autre...
D’un coup sec.
En fermant les yeux.
(Messieurs les enfants, p.99)
|