roman contre malheur
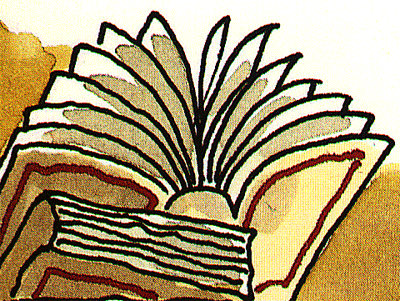
|
Daniel Pennac aime que l’on raconte des histoires aux enfants (d’ailleurs, aux adolescents aussi, comme aux adultes...). Il ne pouvait pas en être autrement, son œuvre foisonne de réflexions sur les textes, sur les romans, sur le récit de l’autre avec lequel on arrive à une si grande intimité. |
Parce que nous avons besoin du récit de l’autre, nous sommes ainsi faits les humains, non seulement on adore écouter les histoires, mais on en a besoin. Pourquoi? Grande question. Pennac avance une réponse: parce qu’il nous faut bien trouver un sens à la vie.
En somme, nous lui avons tout appris du livre en ces temps où il ne savait pas lire. Nous l'avons ouvert à l'infinie diversité des choses imaginaires, nous l'avons initié aux joies du voyage vertical, nous l'avons doté de l'ubiquité, délivré de Chronos, plongé dans la solitude fabuleusement peuplée du lecteur... Les histoires que nous lui lisions fourmillaient de frères, de sœurs, de parents, de doubles idéaux, escadrilles d'anges gardiens, cohortes d'amis tutélaires en charge de ses chagrins, mais qui, luttant contre leurs propres ogres, trouvaient eux aussi refuge dans les battements inquiets de son cœur. Il était devenu leur ange réciproque: un lecteur. Sans lui, leur monde n'existait pas. Sans eux, il restait pris dans l'épaisseur du sien. Ainsi découvrit-il la vertu paradoxale de la lecture qui est de nous abstraire du monde pour lui trouver un sens.
(Comme un roman, p.19)
Et c’est vrai, ce monde, à regarder de près, n’est pas très compréhensible. L’enfant le sent très vite: la perte et le malheur nous guettent. Mais l’adulte se trouve souvent aussi démuni que le petit. D’où l’angoisse du pédagogue réussi. Réussi? Tu parles! Est-ce que que l’on peut continuer à être si fier de soi? Bon sang, si on n’est même pas capable de répondre à cette peur... on va faire comment?
Puis je me retrouve dehors, avec mon chien. Dehors dans la rue. Je marche comme un perdu vers l’école du Petit. Désir insensé de prendre le Petit dans mes bras, lui et ses lunettes roses, de lui raconter le plus joli conte du monde (malheur nulle part, ni au début ni à la fin) et je cherche en marchant (douceur partout, cueillie sans angoisse), et je ne trouve pas, putain de littérature de merde, réalisme à tous les étages, mort, nuit, ogres, fées putrides! Les passants se retournent sur le dingue à tête bosselée accompagné du chien qui tire la langue. Mais ils n’en connaissent pas plus que moi, des contes idéaux, les passants! Et ils s’en tapent! Et ils rient du rire carnassier de l’ignorance, le rire féroce du mouton aux mille dents!
(Au bonheur des ogres, p.167)
Entre parenthèses, c’est le propre des pédagogues réussis de se mettre en question toutes les deux secondes et... de ne pas se trouver réussis du tout! Cela dit, nous remarquons dans les romans de Daniel Pennac diverses tentatives pour cerner le sens du monde, cette explication qui nous rassurerait face aux mystères et aux terreurs de la réalité. Voyons d’abord ces essais d’aborder l’inconnu que représente la croyance dans les forces astrales, les pouvoirs occultes etc...
|

|
Marty n’était pas précisément un sympathisant des sciences occultes. Les tables tournantes, la révolution permanente catégorie astres, le sens de la vie dans le creux de la main, toutes ces salades lui hérissaient le poil rationnel. Il ne tolérait les boules de cristal que solidement vissées aux rampes des escaliers. Elles empêchaient les enfants de tomber sur le cul, un point c’est tout. Pourtant, pourtant...
(La petite marchande de prose, p.238)
Ben et Jérémy ne connaissent que trop l’obsession de Thérèse pour l’ésotérisme. Le grand frère doit contrôler l’autre, toujours prêt à se marrer de Thérèse (ou à l’humilier), mais il perd aussi parfois les nerfs. Car la prose astrale de Thérèse possède la vertu de lui déboîter le système rationnel. Cette éprouvante dialectique trouve son paroxysme dans Aux fruits de la passion, où Ben en profite pour lui faire faire la carte astrale d’un prétendant horrible qu’elle veut épouser:
Thérèse, tu ne vas tout de même pas épouser un mec chez qui "Jupiter dissone avec Pluton!" Allons Thérèse! D'autant plus que ce même type a trouvé le moyen de loger "Mars et Uranus en Maison VIII", ce qui lui garantit "une mort subite et violente!" Thérèse, tu vois bien...
(Aux fruits de la passion, p.70)
Oui, Thérèse est capable de voir des choses assez étranges. Mais c’est bien sa sœur et il l’aime malgré tout. Le grand frère s’exerce donc aussi à esquiver élégamment le moment de la désavouer à jamais. Voyez un bon exemple de réponse d’éducateur. Face à l’accusation d’incroyant, de mécréant qui vous accule toujours, à votre tour, à discréditer la personne en son ensemble, Ben choisit de sortir de l’énoncé accusateur:
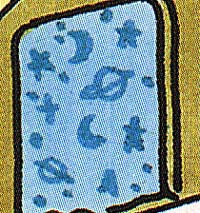
|
|
Mais on l’a déjà dit, un bon nombre de personnages s’allient pour rire ouvertement de ce type de croyances qui nous assujettissent et n’apportent pas de réponse aux questions qui nous angoissent. Une certaine virulence se déchaîne même parfois et on apprécie alors l’image caricaturale (ma non troppo):
Mais quel style tout de même, ces étoiles... Quelle administration, les cieux! "Mercure en Maison IX promet un court voyage à l'étranger... Le rapport à la Maison II suggère un pays riche en banques." Et quelles préoccupations! "Un pays riche en banques"; le cul, le fric et le cul...ô pureté de la voûte céleste!...
(Aux fruits de la passion , p.70)
Parlons-en un peu de la pureté de la voûte céleste. Et Dieu? Eh bien, c’est un thème épineux, vous voyez? Parce que, comment dire?... on n’y comprend rien non plus. C’est vrai. Un bon nombre d’amis morts en de terribles circonstances n’arrange en rien la situation. Ben est en train d’en parler à son futur bébé parce que le souvenir de Pastor, le dernier amant de sa mère, le tourmente. Pennac fait de Dieu, “le divin arbitre”, comme quoi on bascule naturellement dans l’image footballistique:
Le chagrin causé par ceux qui partent fait le nid de ceux qui arrivent dans le cœur de ceux qui espèrent. Il y a lurette que le manège aurait cessé de tourner, sinon.
Bon, mettons que tu sois le suppléant de Pastor dans l’équipe Malaussène. Tu attendais ton tour sur le banc de touche et voilà que le divin arbitre siffle la permutation. Pastor de sortir, à toi d’entrer. On ne peut tout de même pas me reprocher de t’expliquer les règles du jeu à un moment pareil! Tu n’imagines pas comment elles sont tordues, les règles! À se demander, parfois, s’il y en a. On croit bien faire, on suit le parcours fléché, et, sans savoir pourquoi ni comment, on se retrouve accusé de toutes les vilenies du monde.
(Monsieur Malaussène, p.609)
|
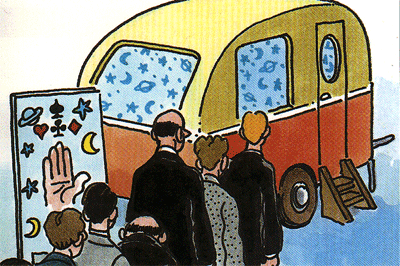
|
Mais là il ne s’agit pas tout à fait de l’humaniser, on serait alors devant une figure de personnification, si l’on peut dire. Personnification de personne sainte, ça doit exister comme figure de rhétorique, sinon il faudrait la créer. Non, nous nous trouvons plutôt face à une dégradation de personne sainte, pure et simple:
- Elle prétend que c’est Benjamin qui lui achetait les tatouages.
- Oh, bon Dieu! murmura Julie.
- Vous ne la connaissez pas, mais elle vous connaît, conclut Gervaise. Elle fera tout pour enfoncer Benjamin.
- Oh, bon Dieu! répéta Julie. Mais pour quelle raison?
- C’est ce qu’il nous faudra découvrir, dit Gervaise, et arrêtez de dire que Dieu est bon, ajouta-t-elle, ça Lui gâte le caractère.
(Monsieur Malaussène, p.455)
Et c’est une ex-nonne qui parle... Certaines remarques prennent ainsi la tournure de la blague, mais c’est que le cadre dramatique n’autorise que peu de concessions aux mauvaises réponses de la voûte céleste. Le discrédit dans lequel sont tombées toutes les personnes saintes devient évident lorsqu’on arrive à leur demander des comptes sur ce qui est de leur ressort, sur les coups bas du destin (enfin de Dieu, non?). Lorsqu’on se révolte contre les drames humains qu’Il permet et tolère:
Depuis que je le planque chez nous, Verdun ne se shoote plus. Quand le passé le prend à la gorge, il regarde juste le Petit, les yeux noyés, et murmure: “Pourquoi qu’t’es pas ma p’tite Camille?” Parfois, il lâche une larme sur le cahier d’écriture, et le Petit dit:
- T’as encore fait un pâté, Verdun...
C’est tellement déchirant que l’ex-séminariste Stojilkovicz, ex-révolutionnaire, ex-vainqueur des armées Vlassov et de l’hydre nazie, que Stojil, présentement conducteur de bus pour touristes CCCP, et pour vieilles dames seules le samedi et le dimanche, que Stojil, dis-je, se racle la gorge et grogne:
- Si Dieu existe, j’espère qu’Il a une excuse valable.
(La fée carabine, p.20)

|
|
Cette irréverence manifeste pour des entités distantes et haut perchées, se traduit parfois par des scènes drôles où le héros semble se débrouiller parfaitement:
Julia se marre doucement:
- Je croyais que tu étais maso, Malaussène, pour accepter ce boulot tordu de Bouc Emissaire, mais non, en fait, tu es une sorte de saint.
Ça doit être ça.
Le saint se fait déposer à la porte du Magasin et se met à rôder dans les allées du rez-de-chaussée. A la recherche de quelqu’un. Quelqu’un de très précis. Qu’il faut que je trouve absolument. Urgence. Il est sept heures du soir. J’espère qu’il ne s’est pas encore barré. Doux Jésus, faites qu’il soit encore là. Allez un bon geste, je ne vous demande jamais rien, Seigneur. Il y a même de fortes chances pour que vous n’ayez jamais entendu parler de moi. Exaucez mon vœu, bordel! Merci! Il est là.
(Au bonheur des ogres, p.127)
Attendez, ce n’est pas fini. Ben trouve Cazeneuve, le traître. Il lui balance un uppercut au foie, le fait dégueuler, “le problème avec les saints, c’est qu’ils ne peuvent pas l’être vingt-quatre heures sur vingt-quatre”.
Le problème avec la sainteté, c’est qu’on n’y croit pas au sens où l’Église catholique le prétend. Pas plus qu’aux autres types de superstitions, d’ailleurs. Petit problème avec la raison, comme signale le père d’Igor. Et je vous fais remarquer que là l’auteur à privilégié le point de vue... d’un mort. Un fantôme se dirige donc à nous, et se permet de parler rationalisme. Je vous assure, on arrive à adorer ce narrateur:
Je sais, je sais, le fantôme agace, et ceux qui croient aux fantômes agacent plus encore, et ceux qui propagent cette croyance méritent de finir comme marque-page séché dans un grimoire... Personnellement, je n’ai jamais été de ceux-là. Rationaliste comme personne. Positiviste comme une addition. Allergique à toute superstition, à commencer par les officielles, celles qui se nourrissent de pain azyme, pissent de l’eau bénite et fondent des civilisations. J’étais si peu enclin à croire, qu’à mes yeux la psychanalyse elle-même relevait du spiritisme. Et n’ai jamais cru aux esprits, ni au mien. Pas d’inconscient, telle était ma devise. Responsable, un point c’est tout. La somme de mes actes, et faire avec. J’étais si peu superstitieux que j’ai emplafonné un nombre incroyable d’échelles qui me barraient le trottoir: je n’arrivais ni à les contourner ni à passer dessous. J’ai toujours préféré me heurter à la réalité.
(Messieurs les enfants, p.77)
|
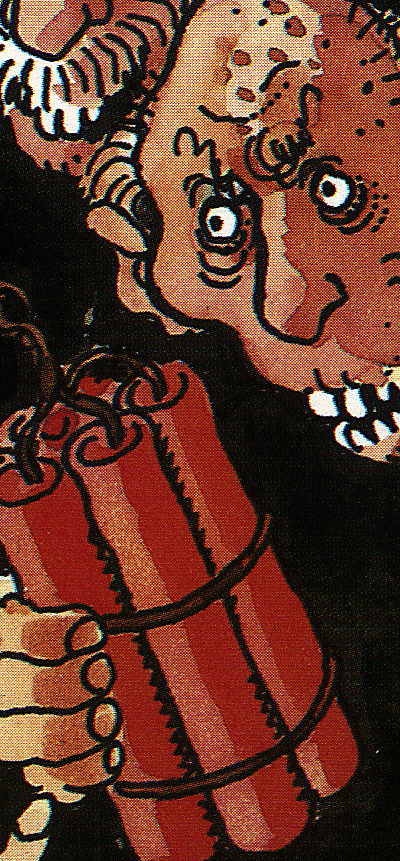
|
Dans La petite marchande de prose Ben accepte de jouer le rôle de l’écrivain JLB pour sortir précisément du “réel”. C’est ce qu’il se raconte lorsqu’il s’imagine devant Julie (Julie qui a fuit de son geste!). Et sa réponse à paradoxalement beaucoup à voir avec le jeu:
Belville s’effritait un peu plus autour de nous pendant que je répétais mon texte. “J’ai accepté de jouer cette comédie pour consoler Clara, ma Julie. J’ai accepté parce qu’il y a des moments où l’horreur frappe si fort et si vrai qu’il faut impérativement sortir du “réel”, comme tu dis, aller jouer ailleurs. J’ai accepté pour faire jouer les enfants ailleurs et qu’ils ne pensent plus à Saint-Hiver. Jérémy et le Petit me feront répéter mon texte, Clara prendra les photos et Thérèse pourra me désapprouver; ça les occupera. J’ai accepté pour obéir à Coudrier, aussi, pour emmener le radeau familial le plus loin possible de son enquête.
(La petite marchande de prose, p.133)
On ne peut pas le nier, c’est surtout par amour qu’il le fait. Parce qu’il lui faut trouver des réponses pour ceux qu’il aime. Le héros de Pennac agit donc. Même s’il doit prendre des décisions vitales sur les siens, c’est fou la confiance dans le genre humain qu’il peut développer. Proportionnelle à la méfiance envers les diverses déités. Quand je vous parlais d’humanisme...Voyons un exemple. Lorsque Julie entre en coma (oui, elle aussi) Benjamin s’en remet au docteur Marty, les yeux fermés:
J’ai perdu les pédales, moi, je m’en remets complètement à ce type que je n’ai vu que deux fois dans ma vie: l’année dernière quand on lui a amené Jérémy coupé en morceaux et rôti comme un poulet, et le jour de la mort de Verdun. Mais c’est comme ça la vie: si vous rencontrez un être humain dans la foule, suivez-le, ...suivez-le.
(La fée carabine, p.224)
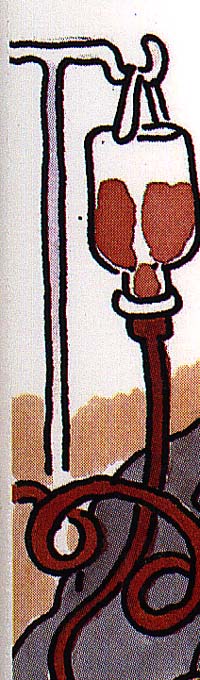
|
|
Une grande vérité! On sent bien que l’amour est quelque chose de “sérieux” pour l’auteur, mais comme il affirme lui-même dans un entretien, c’est très difficile d’en parler, “parce que nous vivons dans un pays où, au moins depuis le XVIIe siècle, vous flatterez quelqu’un en lui disant qu’il est trop intelligent pour avoir du cœur et vous l’insulterez en lui disant qu’il a trop de cœur pour être intelligent”.
Une attitude qu’il trouve par ailleurs ridicule puisque l’amour, l’amitié, les sentiments sont presque les seuls moteurs qui nous maintiennent sains d’esprit dans ce bas monde. Vous allez voir que dans sa façon d’aborder le thème, l’auteur est parfaitement capable de concilier tendresse, sentiments débridés et esprit ludique. Il ne pouvait pas en être autrement, Pennac excelle à combiner amour et humour, inextricables, ces deux-là. On assiste donc à des scènes plus ou moins torrides saupoudrées d’intelligents jeux linguistiques, dans tous les sens que vous êtes en train d’imaginer...
Voyons la première scène d’amour entre Ben et Julie. Le héros vient d’être tabassé à mort. Elle se présente chez-lui. Un dialogue un peu brumeux s’entame: Julia qu’est-ce que tu penses des ogres? Elle se rend compte que le moment n’est pas à la rigolade, et...
Ses yeux paillettes réfléchissent une seconde, puis un immense sourire m’offre le panorama de ses dents. Elle se penche soudain et, tout près de mon oreille, murmure:
- En espagnol, aimer se dit “comer”.
Un sein s’échappe de sa robe dans la brusquerie du geste. Et ma foi, puisqu’en espagnol aimer c’est manger...
(Au bonheur des ogres, p.171)
Ah, les seins de Julie... que je vous parle un peu des préliminaires. Je sais que vous allez apprécier:
Tante Julia se tient debout sur le seuil. Un sourire flotte. Je ne me lasserai jamais de décrire ses vêtements. Ce coup-ci, c’est une robe de laine écrue, tout d’une pièce, qui croise sur la plénitude de ses seins. Lourd sur lourd. Chaud sur chaud. Et cette densité si souple...
- Je peux?
Elle se retrouve assise à mon chevet avant que j’aie pu donner mon avis.
(Au bonheur des ogres, p.170)
|

|
Et comme le thème s’y prêtait, vous pourrez suivre l’intéressant débat sur l’amour qui l'a précédé:
(-Ironie lassante, me reprochait Tatiana à nos débuts, quand elle me voyait cette humeur narquoise. C'est facile de ne croire en rien, de se moquer de tout le monde...
- Je ne crois qu'aux actes, mon amour. Aux petits actes. Les tout petits. Les chiants. Ceux qui font le bonheur du jour et du périmètre, pas plus. Quant aux paroles... Nous avons beaucoup parlé, ma génération et moi, beaucoup, vraiment... Tu vois le résultat?
- Et les sentiments? demandait Tatiana.
- Des sensations qui ont pris la parole.
- C'est agréable à entendre. Vive l'amour...
- L'amour, mon amour, est une somme de petits actes qui racontent en silence une histoire précaire...
- Et si on s'offrait un petit acte, là, maintenant, pour corser l'addition?
Ce fut ce petit acte, là, qui mit Igor en chantier.)
(Messieurs les enfants, p.123-4)
Ce n’est pas qu’il n’y ait pas de la tendresse (je n’ose pas dire romantisme, voir plus bas) dans cette conception de l’amour, loin de là. Mais on en a marre des discours, franchement. Le héros de Pennac agit, nous l’avons dit. Ce sont les gestes qui comptent à la fin, les actes. Et ces actes-là ne manquent pas d’imagination, ni de sens de l’humour.
|
Et si on se méfie des grands discours sur l’amour et des majuscules pseudo romantiques, c’est qu’il faudrait aussi beaucoup parler de l’érosion et de la manipulation subie par les grands concepts. C’est quoi romantique en amour, justement? On se comprend tous sur les mêmes termes, ou est-ce qu’ils renvoient à des réalités différentes? Tout en mettant en rapport amour et roman, l’auteur effleure le problème lorsqu’il se souvient de sa sœur Louna et de Laurent. Leur première rencontre est dessinée avec une délicieuse ironie:
Et je ne sais pas pourquoi, ça m’a fait penser à Laurent, à Louna, à leur rencontre. Elle avait dix-neuf ans, elle montait les escaliers du métro, il en avait vingt-trois et il les descendait. Elle venait d’être plaquée par un zombie qui préférait les abstractions; lui allait présenter son internat de médecine. Il la vit, elle le vit, Paris cessa de circuler. Il n’alla pas passer son concours, et pendant un an ils ne quittèrent pas leur chambre. Je leur apportais des petits paniers de bouffe et de bouquins (parce qu’ils mangeaient, tout de même. Ils avaient même un certain appétit. Et entre leurs voyages interstellaires, ils se faisaient la lecture, parfois même pendant, comme quoi ce n’est pas incompatible.) Dites voir, mesdames, lequel de vos époux cinquante carats vous a sacrifié un grand concours, une pleine année d’études, un an de manque à gagner, comme ça, pour l’Amour, et pour le Roman, hein? Lequel?
(Au bonheur des ogres, p.124)
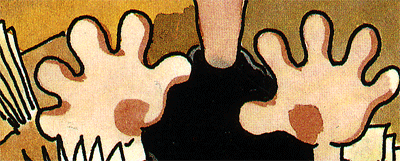
|
De fait on pourrait appliquer aux concepts d’amour certaines réflexions de l’auteur à propos de la littérature en général. De la bonne et de la mauvaise littérature. |
Mais c’est quoi la mauvaise littérature? Eh bien, ce que l’auteur appelle la littérature “industrielle”.
Une littérature qui se contente de reproduire à l’infini les mêmes types de récit, débite du stéréotype à la chaîne, fait commerce de bons sentiments et de sensations fortes (...) pour fourguer, selon la “conjoncture”, tel type de “produit” censé enflammer telle catégorie de lecteurs:
Voilà, à coup sûr, de mauvais romans.
Pourquoi? Parce qu’ils ne relèvent pas de la création mais de la reproduction de “formes” préétablies, parce qu’ils sont une entreprise de simplification (c’est-à-dire de mensonge), quand le roman est art de vérité (c’est-à-dire de complexité), parce qu’à flatter nos automatismes ils endorment notre curiosité, enfin et surtout parce que l’auteur ne s’y trouve pas, ni la réalité qu’il prétend nous décrire.
Bref, une littérature du “prêt à jouir”, faite au moule et qui aimerait nous ficeler dans le moule.
Ne pas croire que ces idioties sont un phénomène récent, lié à l’industrialisation du livre. Pas du tout. L’exploitation du sensationnel, de la bluette, du frisson facile dans la phrase sans auteur ne date pas d’hier. Pour ne citer que deux exemples, le roman de chevalerie s’y est embourbé, et le romantisme après lui. A quelque chose malheur étant bon, la réaction à cette littérature dévoyée nous a donné deux des plus beaux romans qui soient au monde: Don Quixotte et Madame Bovary.
(Comme un roman, p.180-2)
Cette reproduction de “formes” préétablies qui endorment notre curiosité s’apparente parfaitement à une conception de l’amour, sous étiquette romantique, dans laquelle justement on ne voit pas l’auteur, son style, ni la réalité qu’il prétend nous décrire. Une conception de l’amour faite de signes externes, d‘apparences, “faite au moule”. Si on parle d’amour et on ne voit pas l’auteur, on ne sent pas la “voix” de l’amant, pire encore, si on ne voit que ces cinquante carats dont parlait Benjamin, alors là on a droit de crier à l’imposture, au mensonge. Il en va de même pour le roman.
|
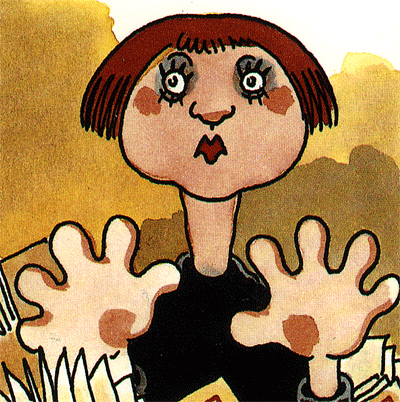
|
Lutter, aimer, écrire, le héros de Pennac ne cesse d’agir. Voyons un peu Jérémy tout déconfit parce que son récit de 30 années incompressibles n’a pas plu à son public:
Je l’ai retrouvé dans la cuisine, sa tête de poète maudit plongée dans ses bras repliés, parmi les assiettes sales, les pelures de pommes et autres reliquats que nous n’avons pas eu le temps de débarrasser, tellement il était pressé de nous lire ses cinquante dernières pages, le pauvre.
J’ai choisi la manière directe:
- Arrête ton char Rimbaud, et donne-moi un coup de main pour la vaisselle.
Tout en empilant j’ai demandé:
- Comment ça finissait, ton chapitre?
Sollicitez l’auteur et vous vaincrez le chagrin. Il m’a expliqué le topo en rassemblant les couverts.
(Monsieur Malaussène, p.519)
Et il faut signaler que c’est grâce à l’écriture que Jérémy commence à trouver un peu de sens à la vie. On l’a vu se débarrasser de vieilles peurs. Souvenez vous de la rage et de l’ennui avec lesquels il affrontait les problèmes de grammaire: pourquoi cette saloperie de participe passé s’accorde avec ce connard de COD quand il est placé avant cet enfoiré d’auxiliaire être? On peut affirmer que trois romans plus tard, cette rage, cette hantise, et bien d’autres tendances asociales ont disparu. La passion qui le guide maintenant ne peut que l’aider à surmonter le malheur:
Zabo... Depuis qu’avec la disparition du Zèbre, la reine Zabo a décidé de métamorphoser l’homme de théâtre en romancier, elle le chouchoute, notre Jérémy! Il lui fourgue sa production tous les deux jours. La reine et l’apprenti s’enferment dans le bureau directorial et ça négocie ferme à ce qu’il paraît. L’apprenti défend son bout de gras, il cède facile sur les fautes d’orthographe, de syntaxe, de composition, sur l’excès d’enfantillage et autres scories de l’immaturité, mais il se bat comme un communard pour la sauvegarde de la péripétie. La reine estime qu’il en fait trop. Le feutre crisse, les ciseaux claquent. Les éditions du Talion en retentissent. On rase les murs dans les couloirs. Ruptures et réconciliations. La Reine approfondit les thèmes, Jérémy fignole le pathétique. La Reine voudrait une écriture plus ronde. Jérémy s’en tient à la façon Malaussène: “C’est comme ça qu’il parle, Benjamin, c’est comme ça qu’il nous raconte, et c’est même comme ça qu’il pense! Je le connais mieux que vous, quand même! -Penser, parler, écrire sont choses différentes!” rétorque la Reine, plume en main et preuves à l’appui. La bataille des styles dans la guerre du roman. La reine sait ce qu’elle veut. Et elle l’obtient, tout en s’arrangeant pour que Jérémy continue de s’en croire l’auteur. Le plus jeune romancier de France!
(Monsieur Malaussène, p.520-1)
C’est aussi simple que ça, malheur et passion s’excluent normalement. Procurez-vous une belle passion et vous verrez comment se dilate le temps de vivre. La passion de l’écriture est donc mise en relief mais elle se présente comme fille naturelle de la passion pour les histoires tout court. Et c’est des histoires racontées par son frère dont Jérémy se souvient tandis que Benjamin, en prison, proclame la liberté totale du récit et l’incroyable pouvoir du roman:
Tu veux que je t’en lise un bout?
Personne n’a jamais trouvé le courage de répondre non à ce genre de question.
- Volontiers, c’est très gentil à toi.
- Après toutes les histoires que tu nous as racontées quand on était mômes, c’est la moindre des choses, Ben...
Tricote, Jérémy, tricote... invente-toi un héros de roman, un frère irréprochable fourvoyé dans la culpabilité des autres... tricote... et donne-toi un joli rôle, tant que tu y es. Quand la vie est ce qu’elle est, le roman se doit d'être ce qu’il veut.
(Monsieur Malaussène, p.478)

|
|
La fin du corrigé regorgeait d'un bonheur à ce point académique (mariage d'Eric et de Rachida, remariage d'Ismaël et de Tatiana) qu'il y eut deux ou trois grincheux pour s'en offusquer.
- Pourquoi ça finit si bien, monsieur? demanda le plus téméraire, en tordant une bouche critique.
- Parce que tu finiras mal, mon petit bonhomme, répondit M. Crastaing, et moi aussi, ajouta-t-il, il suffit de le savoir, ce n'est pas la peine d'en rajouter.
(Messieurs les enfants, p.256)
L’auteur le remarque dans un entretien récent. Développer un roman lui permet de se submerger dans la langue française, parce qu’en elle quelque chose de lui vit absolument; tandis que dans la réalité il a souvent la sensation de manque d’oxygène face à toutes les saloperies contre lesquelles il ne peut rien. Il fait servir alors la figure de la baleine qui sort respirer à la surface pour, à nouveau dans l’eau, pouvoir créer l’illusion d’arranger tout le malheur aperçu là-dehors. Face au malheur donc, face à la mort et au sentiment de perte, le roman devient un besoin... vital:
- Mais il avait un gros défaut, maman.
Tatiana se raidit, imperceptiblement.
- Il était mortel.
Et c’est la catastrophe, la rupture de barrage, les sanglots dans la purée, sous l’œil impuissant du lapin, le débordement de la douleur.
- Et il est mort, maman!
Curieux, le chagrin. Le plus authentique des chagrins se défend contre lui-même en faisant des phrases. C’est cela, peut-être, la nécessité littéraire, ce besoin vital d’écrire autour... Il n’y aurait qu’à mourir avec les morts, autrement.
(Messieurs les enfants, 43-44)
|
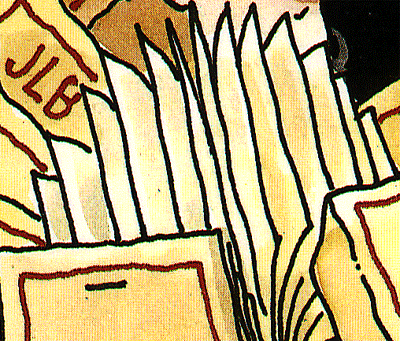
|
L'homme construit des maisons parce qu'il est vivant, mais il écrit des livres parce qu'il se sait mortel. Il habite en bande parce qu'il est grégaire, mais il lit parce qu'il se sait seul. Cette lecture lui est une compagnie qui ne prend la place d'aucune autre, mais qu'aucune autre compagnie ne saurait remplacer. Elle ne lui offre aucune explication définitive sur son destin mais tisse un réseau serré de connivences entre la vie et lui. Infimes et secrètes connivences qui disent le paradoxal bonheur de vivre alors même qu'elles éclairent l'absurdité tragique de la vie. En sorte que nos raisons de lire sont aussi étranges que nos raisons de vivre. Et nul n'est mandaté pour nous réclamer de comptes sur cette intimité-là.
Les rares adultes qui m'ont donné à lire se sont toujours effacés devant les livres et se sont bien gardés de demander ce que j'y avais compris. A ceux-là, bien entendu, je parlais de mes lectures. Vivants ou morts, je leur donne ces pages.
(Comme un roman, p.197)
C’est... beau. Tout simplement. Je ne vous concocterai pas un exercice, comme à la fin de chaque section du cours. Je ne vous demanderai donc pas ce que vous avez compris, mais n’oubliez pas tout de même de jeter un coup d’œil à l’évaluation.